Korhogo c’est l’histoire d’un week-end, d’une future coloc qui me parle déjà de mon nouveau pays d’accueil, d’un ex venu du nord assez secret sur ses coutumes. Il comparait Korhogo à Tamale, ville ghanéenne découverte lors de notre précédent voyage au Ghana, sans pour autant s’émanciper sur le sujet. Korhogo, c’est une ville entre traditions et modernité, comme un rite de passage qui nous ouvre les portes du sacré.
Départ pour Korhogo
Situé à 563 km d’Abidjan en passant par Yamoussoukro, Korhogo se ralie en 8h en voiture ou 10h en bus. Je choisis la compagnie de bus GTKA nouvellement ouverte et récupère mon billet la veille en gare d’Adjamé. Plusieurs compagnies se rendent au nord… vous n’aurez que l’embarras du choix.
Veille du week-end de Pâques, le bus est complet et je suis bien sûr la seule blanche dans le convoi. Chacun rejoint sa famille pour le week-end prolongé et retourne au village.
Le temps passe vite avec un petit somme par-ci, un arrêt pipi par-là et les séries africaines façon télénovella. Je suis toujours impressionnée par la dextérité des femmes qui descendent pour uriner, enroulant un pagne autour de la taille… je n’ai jamais testé ayant bien trop peur de le mouiller (à savoir que le bus s’arrête souvent au milieu de nulle part). Très peu d’échange avec mon compagnon de route cette fois, qui m’offre tout de même un bonbon pour la gorge. Je plonge doucement dans mes souvenirs d’Inde, où cette vieille femme toute ridée m’avait offert le plus beau des sourires.
Je finis par arriver à destination, légèrement perdue… ici ce ne sont pas des taxis voitures, mais des taxis moto comme au Bénin et je ne connais pas le nom du quartier que je cherche à rejoindre. Heureusement, nous sommes en Afrique… les gens sont toujours ravis de vous aider. Je demande ma route à l’assistant du chauffeur, qui m’assoit à côté de deux personnes âgées habillées de leurs boubous majestueux, et qui me propose de l’attendre dans la gare du bus le temps de sa prière. Il finit par me rejoindre et me dit qu’il m’amène à destination: au Centre d’Hébergement de Korhogo, se situant à la cathédrale. Ce dernier propose des chambres toutes simples, avec lit, ventilateur, douche et wc pour 5000 FCFA la nuit (soit 7€). Des chambres climatisées sont également à disposition.
Arrivée au centre, je demande où je peux aller manger et un gars rentrant chez lui à vélo décide de m’accompagner sur la route… jusqu’à ce que j’entende mon prénom: « Lucie, c’est Mamadou ».
Mamadou
Mamadou est le guide que j’ai contacté quelques jours plus tôt, qui m’a été conseillé par une amie. Nous avions échangé via whatsapp et je n’avais rien conclu avec lui car je préfère rencontrer les gens en face, afin de mieux les cerner. Rien qu’avec ma photo sur whatsapp (et surement ma couleur de peau) Mamadou m’aborde comme une vieille amie qu’il vient de croiser dans la rue. « C’est incroyable, je venais justement en ville pour acheter du crédit et t’appeler ! » me dit-il. Les étoiles sont alignées, pensais-je.
 Mamadou est un Sénoufo, ethnie ivoirienne que l’on rencontre au nord du pays. Il vient du village de Waraniéné, dont un de mes invités sur mon éductour quelques jours auparavant m’avait parlé.
Mamadou est un Sénoufo, ethnie ivoirienne que l’on rencontre au nord du pays. Il vient du village de Waraniéné, dont un de mes invités sur mon éductour quelques jours auparavant m’avait parlé.
Mamadou a le sourire facile. Je sens qu’on va bien s’entendre…
Il m’invite à m’assoir pour un plat de riz, poisson sauce (pour 500 fcfa) dans un buibui du coin et on commence à échanger sur le but de mon voyage. Je lui sors la liste de mon vidéaste ivoirien préféré et il me garantit qu’en 3 jours, je peux tout faire sauf la belle mosquée en bambou qui est bien trop loin. Je négocie doucement le prix et on scelle notre accord avec un large sourire et une bonne poignée de main. Il me raccompagne sur son scooter du nord et je me dis que ces trois prochains jours vont être à la hauteur de mes espérances.
Pour le contacter: +22507116110
Sur la route des artisans
Le lendemain, il me récupère à l’heure prévue me prêtant un casque et nous nous mettons en route. Au programme du jour: Kapélé, Waraniéné et le Mont Korhogo.
Kapélé et ses perles colorées



Nous commençons par Kapélé où nous trouvons les artisans qui créent encore les perles à la main. On m’explique qu’après avoir récupéré l’argile au bord de la rivière, on forme des boules que l’on enroule autour d’une tige (celle utilisée pour filer le coton), pour former le trou. Une fois la base créée et sèche, ils mettent les perles au four (dans un trou recouvert de branchages) pour les figer. C’est alors que l’artiste peut commencer à les peindre. Ici les couleurs naturelles sont les seules utilisées: le blanc vient du kaolin, le jaune de la terre, le vert des feuilles de kinkalba et le rouge du teck.
Pour créer des formes aussi nettes, le peintre coince la tige en bambou entre ses orteils pour la faire tourner, tandis que le bout d’une plume lui sert de pinceau.
J’ai du passer une heure à observer les œuvres de ces hommes du nord. Ce travail est réservé à ces derniers et les perles étaient autrefois utilisées lors de cérémonies. Aujourd’hui c’est toujours le cas, mais une partie est laissée aux touristes et vendue sur les marchés. J’ai failli tout acheter, mais je me suis dit que vous aussi vous aimeriez porter un de leurs colliers. Je me suis donc contentée de quelques boucles d’oreilles pour les copines, un collier nature (non verni à la sève des arbres) et quelques perles magnifiques en vrac. Mamadou me presse légèrement, me disant en souriant qu’il y a encore plein de choses qui m’attendent.
Les tisserands de Waraniéné



Nous filons dans son village pour découvrir les tisserands de Waraniéné. J’avais déjà eu le plaisir d’observer le travail de ceux de Man, mais avec les explications de Mamadou la découverte est complète. Il m’explique alors que les femmes filent le coton que l’on trouve dans la région et que les hommes sont en charge de la confection des bandes, qui serviront ensuite à la confection de boubou ou de nappes. Les plus jeunes attachent les bouts de coton entre eux pour former de longues lignes, qui sont ensuite installées sur les métiers à tisser. Ils s’entrainent ensuite sur des motifs faciles tandis que les plus expérimentés tissent des motifs plus détaillés. Ils passent leur journée à tisser et il faut savoir qu’une pièce peut prendre 3 jours.
On me propose de tester et je m’attèle avec attention à la tâche. Mes pieds sont trop courts pour les pédales (chaque métier à tisser est réglé à la taille de son artiste), qui permettent d’intervertir les bouts de coton alignés en haut et en bas. Heureusement le jeune artisan m’aide et je fais passer la pelote à droite et à gauche, tout en tassant mon tissage avec le morceau de bois suspendu.
Les pagnes traditionnels sénoufo sont magnifiques et la tentation est encore grande… je me laisse le week-end pour réfléchir. Mamadou m’accompagne dans sa famille pour le délicieux repas du midi.
Le rocher sacré de Chien Léo
 Le rocher sacré de Chien Léo se situe à 10 min de Korhogo. Ces lieux sacrés africains me font bizarrement penser aux lieux sacrés aborigènes. On y retrouve toujours cet ensemble de gros cailloux qui tiennent debout comme par enchantement.
Le rocher sacré de Chien Léo se situe à 10 min de Korhogo. Ces lieux sacrés africains me font bizarrement penser aux lieux sacrés aborigènes. On y retrouve toujours cet ensemble de gros cailloux qui tiennent debout comme par enchantement.
Ici un homme est assis sous l’un des gros rochers. Mamadou m’explique que c’est le gardien, celui qui effectue les sacrifices pour chaque passant. La personne va amener un poulet au gardien, qui va le sacrifier et mettre du sang et des plumes sur la pierre pour remercier les esprits de leurs bonnes grâces. Le poulet va ensuite être mangé sur place.
Un peu plus loin derrière, ce sont des femmes qu’on rencontre, attendant sagement avec leurs grigris la personne qui voudra faire appel à leurs dons. Je rencontre l’une d’elle, pour un échange émouvant.
Carrière de granit


Changement d’atmosphère avec la découverte de la carrière de granit. Mamadou m’explique que ce dernier est encore récolté à la main dans cette carrière. Des bouts de bois chauffés sont glissés à travers les fentes pour dégager les plus gros morceaux. Femmes et hommes travaillent ensemble et les enfants sont souvent sur place (au lieu d’aller à l’école) car le repas est cuisiné au cœur même de la carrière par chaque famille. Nader, le blogueur rencontré sur un voyage de presse, m’expliquait que les travailleurs gagnaient environ 1000 FCFA par jour (soit 2€). Vendredi, jour de ma visite, très peu de monde était présent à la carrière, car la plupart des familles vont à l’église. Trois messieurs nous accueillent près de leur abris et nous proposent le meilleur des thés (ah que je l’aime ce thé… vert de Chine, chauffé à l’ancienne avec un brin de gingembre et beaucoup de sucre). Mamadou me raconte qu’une carrière avec des machines s’est installée dans le coin il y a quelques années, limitant le prix d’achat du granit. Heureusement les hommes lui confirment qu’ils arrivent aujourd’hui à maintenir leurs conditions de vie grâce à certains fidèles qui viennent encore leur acheter le granit taillé à la main.
Je sors pantoise de cette visite et me dit qu’heureusement je n’ai vu personne travailler sous ce soleil de plomb.
Ascension du Mont Korhogo
Après une journée bien remplie, nous filons au marché de Korhogo où Mamadou tient à me montrer la partie réservée aux guérisseurs. On y trouve de tout: des crânes de singe, des peaux de serpent, des bracelets en argent réservés aux grigris, etc.
Puis nous montons jusqu’au sommet du Mont Korhogo surplombant la ville du nord. Les nuages omniprésents ne laisseront pas le soleil nous illuminer de sa superbe, mais j’en profite pour papoter avec mon guide sur les traditions ivoiriennes.
Sur la route des Baobabs
Le lendemain, nous prenons la route de Fakaha pour aller admirer les Baobabs. Le premier a plus de 200 ans et le fruit du Baobab aurait de nombreux bienfaits sur l’organisme. La partie jaune est notamment utilisée dans une des sauces locales, et j’ai vu qu’une femme à Abidjan en faisait des bonbons.



Puis nous reprenons la route vers Fakaha pour la découverte des fameuses toiles de Korhogo.
Fakaha et ses peintures sur toile
On a l’habitude de les appeler « toiles de Korhogo » et pourtant c’est bien dans le village de Fakaha que les artistes se mettent à l’œuvre. Les peintures sont ici aussi à base de couleurs naturelles, posées sur des tissus en coton local, tissés à Waraniéné. Soro Navaga, l’artiste dessine les contours au couteau puis m’explique qu’il doit d’abord poser une base de peinture marron, afin que la couleur noire puisse accrocher au tissu.


Il me raconte aussi que Picasso est venu jusqu’à Fakaha pour apprendre de ces artistes du nord et que c’est lui, qui aurait recommandé à la communauté, de faire des contours sur leurs toiles pour faire ressortir leur œuvre comme dans un cadre. Soro me sort alors la vieille toile peinte par Picasso, qu’il garde précieusement loin de la poussière orangé, qui aura fini par revêtir mes jambes d’un joli bronzage artificiel lors de nos trajets en moto. Ce travail est à nouveau réservé aux hommes, et j’observe les plus jeunes s’entrainer sur de petites toiles (dont les touristes sont friands).


Je finis par acheter une belle toile de Fakaha, pensant qu’elle me rappellera mon échange avec ce vieil artiste sénoufo. Je lui fais tout de même remarquer qu’il n’y a, à ma connaissance, pas de girafe en Côte d’Ivoire. Les toiles représentent, en effet, souvent des animaux ou des rites initiatiques sénoufo.
Le plus grand antiquaire de Korhogo
Il est temps de retourner sur Korhogo et d’aller rencontrer le plus grand antiquaire de la ville, Mr Souleymane Arachi. Il m’ouvre la porte d’un petit hangar dans le quartier Haoussabougou et j’y découvre des masques entassés à l’abri de la lumière. Il m’invite à y rentrer, tandis que Mamadou s’installe confortablement sur la chaise en bois posées devant.
Je suis un peu apeurée par le nombre de masques, et je dis en rigolant que ces derniers me font peur. Il me fait sortir de l’hangar et m’ouvre une autre porte… il y en a tout autant. Ce n’est pas 2 pièces qu’il finit par me faire visiter mais au moins 10 ! Je suis stupéfiée par le nombre d’antiquités qu’il collectionne. Il me raconte alors que c’est une histoire de famille, et que son père en est le précurseur. Pour sa part, il s’en va chercher de belles pièces délaissées dans les villages de la région, où les chefs du village lui racontent souvent que tel ou tel masque a servi à telle cérémonie ou telle occasion. Et c’est là que je le vois…
Un vieux masque Sénoufo, anciennement utilisé pour une cérémonie, caché sous d’autres masques. C’est sa couleur patinée par le temps qui m’attire… mais le manque de place dans mon sac du week-end et dans mon sac pour un retour en France imminent, font que je le laisserais parmi l’un de ces hangars.
Les sculpteurs de Koko
Certains masques ne sortent que pour certaines cérémonies ou certains initiés. C’est-à-dire que les non-initiés n’ont pas le droit de voir certains masques.
Mamadou m’entraîne dans le quartier des sculpteurs non loin de la Grande-Mosquée, où chacun a son petit réduit avec une micro-galerie. Ayant passé beaucoup de temps chez Mr Souleymane, il est vrai que je n’ai plus beaucoup d’énergie à consacrer à ces artistes de tout âge. Je prends tout de même le temps de visiter chaque galerie et le dernier jeune homme me remercie, tout fier de pouvoir me montrer son travail. Ce sont tous de grands passionnés et je suis admirative de ce qu’ils peuvent faire de leurs mains. Travailler le bois, quel métier ♥
J’en apprends donc un peu plus sur la signification de ces masques… On me montre des masques aussi petits que ma main, que l’on appelle « masque passeport ». Tel un passeport ou une carte d’identité, ils indiquaient à l’époque de quelle région le propriétaire venait, que ce soit en Côte d’Ivoire, au Mali ou au Burkina Faso. Le calao, grand oiseau que l’on retrouve un peu partout dans le pays, est un animal protecteur. Plusieurs significations lui sont associées et on le retrouve souvent sur les masques sénoufo.
Funérailles
Le soir Mamadou me convie à des funérailles. Un peu mal à l’aise à l’idée, pensant que ce n’était pas ma place, je me retrouve finalement parmi la foule joyeuse, riant, chantant et dansant au son du balafon et autres instruments.
Le balafon est cet instrument construit avec une base en bois, reliée par de la peau de chèvre, sur lequel on ajoute de belles pièces encore en bois à l’image d’un xylophone. La différence ici est que sous chaque morceau se trouve une calebasse de taille différente, permettant au son une résonance impressionnante et une mélodie variée.
C’est à ce son que j’observe avec timidité la famille dansant dynamiquement et l’ensemble de la communauté réuni pour célébrer l’être vivant qui vient de décéder.

Cases à fétiche et karité
Dernier jour de visite et nous partons à 60km de Korhogo, à Niofoin. Sur la route, nous ne manquons pas de croiser les policiers, toujours avides de récupérer le n° de téléphone d’une femme blanche (pour se marier soit-disant) et quelques dozos, personnages hautement respectés en Côte d’Ivoire pour leurs secrets de chasse et gardien de certains pouvoirs mystiques.
Village de Niofoin
Nous finissons pas arriver à Niofoin où Mamadou m’explique qu’ici vivent des animistes et que dans la tradition, l’homme a droit de se marier avec plusieurs femmes. Ainsi l’homme a sa propre case et les femmes autour ont la leur qu’elles partagent avec leurs enfants. De petits constructions servent de grenier, où la récole y est rangée. Ces dernières sont légèrement surélevées pour protéger la récolte des inondations. Les graines sont récupérées par le haut, en enlevant le toit, tout au long de l’année.
La case à fétiche est la seule construction, où le toit est renforcé chaque année, d’où son chapeau impressionnant (qui sert d’ailleurs de refuge à certains oiseaux).
C’est ici que les habitants du village viennent prier, faire des sacrifices et remercier les esprits à travers des offrandes. La case a une allure impressionnante et mystique.


Comme dans tous les villages que nous avons traversés, je laisse quelques savons aux personnes qui m’accueillent, sur les conseils de Mamadou. Il est assez mal vu de venir sans rien, mais cela crée une attente envers les touristes. Ainsi les enfants qui me couraient après dans l’espoir d’avoir des bonbons m’ont fait culpabiliser, pensant bien faire de ne pas vouloir leur en donner. Le guide leur expliquait alors que ce n’était pas bon pour les dents (excuse que je lui ai sorti lorsqu’il me parlait d’en acheter pour les enfants). Je ne sais toujours pas quelle position tenir à ce sujet… Et vous ?
Beurre de karité
Nous rentrons ensuite sur Korhogo, dans le quartier du Petit Paris, à la rencontre de la coopérative de beurre de karité. Ici seules les femmes travaillent, et la vente du karité leur rapporte un petit revenu tout au long de l’année. C’est un travail de longue haleine. Il faut d’abord récolter les graines (juin-septembre), enlever la première couche verte et la pulpe, laisser les noix obtenues sécher au soleil. Ces dernières peuvent alors être conservées pour le reste de l’année. On concasse ensuite les noix pour obtenir les amandes. Lavées, séchées au soleil, elles sont ensuite passées au moulin pour obtenir de petits morceaux. Ces derniers sont mélangés avec de l’eau et c’est l’étape du barratage. Les femmes brassent la pâte obtenue avec de longues spatules, tandis que le mélange chauffe. L’huile remonte à la surface, tandis que les impuretés restent en bas. Ces dernières sont récupérées pour former des boules, qui serviront de bio-charbon pour faire chauffer les futures marmites. Le beurre est ensuite récupéré et stocké.
Ici le kilo équivaut à 1000 fcfa (soit 2€) ! Le beurre a une couleur légèrement jaune et une odeur plus marquée que ce que l’on trouve en commerce, mais avec un max de principes actifs. Celui que l’on achète blanc et sans odeur a été raffiné, mais on perd de suite en qualité. Il est donc possible de rajouter quelques huiles essentielles pour équilibrer l’odeur. Et au moins ici, on sait que l’argent bénéficie directement aux productrices (parce que 10€ le beurre de karité bio… c’est choquant, vu le prix initial !).




Il est déjà temps de partir, Mamadou a une dernière surprise pour moi.
Danse Boloye
N’ayant pas les moyens de m’offrir une danse traditionnelle à moi toute seule (compter 40000 Fcfa, soit 60€), Mamadou m’intègre à un groupe. Tout au long de mon séjour, mon guide m’explique un peu ce qu’est le « Poro », qui est l’un des rituels initiatiques (le plus courant) par lequel doit passer chaque jeune sénoufo. Il est le fondement de la vie sociale, religieuse et politique. Ce que j’appelle « initié » tout au long de l’article, est quelqu’un qui a reçu ou est entrain de recevoir cet enseignement. C’est principalement au cœur de la forêt sacrée, attenante à chaque village que le sénoufo le reçoit.
Il faut savoir que chaque village de la région est divisé en deux: la partie musulmane avec sa mosquée et la partie animiste avec sa forêt sacré. Il y a dans chaque village deux chefs: l’un musulman et l’autre animiste, qui se rencontrent lors des grandes décisions attenantes au village.
C’est à Waraniéné, le village des tisserands, que nous retournons pour admirer la danse boloye. Cette dernière fait partie des rites initiés et c’est l’une des rares danses qui peut être montrée aux yeux des touristes. La danse boloye est aussi connue sous le nom de danse panthère, faisant référence à l’accoutrement des danseurs (à savoir que les panthères existent en Côte d’Ivoire).


Vous l’aurez compris Korhogo et la région des Savanes regorgent de surprises. Que vous aimiez l’art, l’artisanat, la culture, les traditions, les rencontres, les mythes, l’agriculture (avec ses champs de coton et d’anacharde), les initiatives durables, etc. le nord de la Côte d’Ivoire en est riche. Ce petit week-end prolongé m’a beaucoup touché, sans que je puisse expliquer pourquoi. De voir que les locaux ont réussi à garder leurs coutumes malgré la colonisation et qu’aujourd’hui ses dernières attirent quelques touristes curieux, me laisse un doux goût de satire.
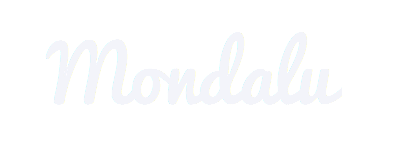


Chouette article.
Pour les bonbons aux enfants, on avait été confronté à un problème similaire en visitant de petits villages de pêcheur au coeur de la forêt amazonienne péruvienne.
On leur avait acheté des crayons et cahiers qu’on a confié à l’instituteur du village.
Merci Romain. C’est une idée 🙂 J’espère que la Nouvelle-Zélande prend bien soin de vous.
Je retrouve tout à fait le Korhogo que j’ai connu ! Sympa cet article !
Super ! L’occasion de replonger dans quelques souvenirs ? 🙂 Contente que cet article t’ait plu.
L’attente de petits cadeaux n’est pas réservé aux touristes n’est pas réservée aux touristes mais est bien une tradition africaine. J’ai des souvenirs nostalgiques des grands-mères qui lors de leurs visites en ville nous ramenaient du néré ou du baobab du village que nous snobions ou de mon arrière grand-mère recluse à la maison qui mettait de côté les meilleures morceaux de ses repas pour nous les offrir après. Mon cousin qui était trop jeune pour refuser a une fois frôlé l’indigestion avec une friandise gardée trop longtemps.
Merci pour cette histoire qui nous fait voyager dans le temps 🙂