La Ciudad Perdida m’avait été évoqué quelques semaines avant de partir sur mon voyage en Colombie. Un ami me parlait de ce trek mythique à la rencontre des populations locales, au cœur d’une jungle fournie au nord-est du pays. « Le Machu Picchu du coin » m’avait-il dit. Alors que je n’aime pas comparer les merveilles d’un lieu à l’autre, sa description avait éveillé ma curiosité. Après quelques recherches, j’avais signé pour 4 jours de randonnée au départ de Santa Marta.
Jour 1 : Premiers pas dans la Sierra Nevada de Santa Marta
Au départ de Santa Marta
J’émerge à 4h du matin alors que mon réveil sonne 3h plus tard… La joie des auberges de jeunesse ! Le jour s’est déjà levé sur Santa Marta lorsque mes yeux s’ouvrent pour la deuxième fois.
Petit-déjeuner. Chaleur matinale. Le yaourt servi sur le granola ne passe pas. L’appréhension ou la chaleur trop intense ? Une bouteille d’eau fraiche achetée et je me retrouve dans les bureaux de Wiwa Tours, attendant patiemment ceux qui seront mes compagnons de route.
Deux polonais débarquent. Vais-je tenir la chandelle de ce couple que je ne connais pas ? Nous partons pour 2h de route en direction de Palomina. Un peu d’attente sur l’autoroute, de nouveaux passagers, un bracelet rose autour du poignet et nous voilà, empruntant la route cabossée par les coulées aqueuses de la jungle. J’y retrouve une sensation de déjà-vu ivoirienne. Pourtant ici, tout le monde parle espagnol.
Première étape de la Ciudad Perdida
La première montée à 12h assomme. Mon corps sut à grosses gouttes et je pense alors que mes kilos engloutis lors de mon année au Canada vont fondre sur ces 4 jours. Mes peines de cœur y passeront peut-être aussi. Le terrain est facile. Moins, la chaleur qui assomme.
Heureusement à chaque pause, des boissons fraiches se disposent, la vue s’ouvre sur les reliefs contrastés par les aspérités météorologiques. Une pastèque se déguste avec plaisir et nos doigts se plongent dans un mélange de miel et cacao cru torréfié : un délice ! Petit coup de boost assuré avant de découvrir notre camp du soir, vers 15h, pour une douche froide, méritée.
Culture de la Sierra Nevada
Après le diner, agrémenté de poissons, pomedoro et riz, Carlos nous raconte que 4 peuples vivent sur le territoire de la Sierra Nevada : les Wiwas, les Arhuacos, les Kankuamos et les Kogis. Leurs positions géographiques dépendent du niveau de la mer, à l’image d’une pyramide dominé par les Kogis. Il suffirait de connaître la signification de leur nom pour savoir à quelle étage ils se trouvent.



Carlos, lui-même Wiwa, nous parle de son poporo qui lui a été attribué à son passage à l’âge adulte. Il n’y a pas vraiment d’âge précis, nous dit-il, cela dépendrait de chaque année/individu. En possession de son poporo, le jeune homme est prêt à se marier.
Plus tôt dans la journée, j’avais baragouiné quelques mots d’espagnol pour créer une connexion avec ce guide que je trouvais distant. Il était alors en train de mâcher des feuilles de coca, tout en tournant un bâtonnet autour d’une calebasse de couleur vert eau, jaune clair : son poporo.
En créant des mouvements circulaires avec le bois sacré, préalablement trempé dans une pâte blanche (venant de sédiments marins), il y dépose ses pensées. La calebasse finit par gonfler au contact du mélange de coca et de coquillages écrasés. Lorsque sa taille devient trop importante, on la laisse chez soi pour en emporter une autre, à l’image d’une méditation constante.
Je me sens mal d’avoir dérangé Carlos dans ce processus et décide de ne plus chercher ce lien qui ne viendra jamais. Vêtu de sa tenue blanche (représentant la pureté), il nous conte que ses cheveux longs sont associés aux rivières, tandis que sa langue maternelle feraient écho aux grondements du tonnerre.
Jour 2 : Au cœur de la jungle
Pas à pas au chant des cigales
Le jour se lève et le réveil n’a pas le temps de sonner. La lumière passe du orange au vert bleuté. Le petit-déjeuner s’avale rapidement et nous prenons la route à 6h.
Hier, la pluie a rendu le terrain glissant. Il va falloir s’accoutumer des pieds dans la boue. Le chemin a rétréci parmi la jungle enjouée. Le chant des cigales stridant nous accompagne tandis que nous jonglons avec les roches mouillées. Ça monte doucement puis ça redescend à mon plus grand malheur : il va falloir que je trouve un bâton.



Après 2h30 de marche, l’orée d’une pastèque fraichement coupée nous appelle avant de laisser les moustiques nous dévorer. Vite ! Nos jambes se précipitent dans la boue pour finalement se délecter de la fraicheur de la rivière, posée là telle une piscine naturelle. Nous rejoignons le campement pour le déjeuner.
Repus, nous arpentons le chemin qui s’élance dans la forêt. Les pieds zigzaguent à travers les cailloux. Ça monte, ça descend rapidement. La chaleur ralentit nos corps fatigués. Il nous reste la grosse montée. Les premiers mètres se font avec facilité. On laisse le guide à la traine, puis la cadence s’inverse. Tout à coup mon énergie se fait aspirer par l’humidité tropicale et les coups d’huile essentielle de menthe poivrée ne suffisent plus à me requinquer. Le rythme ralentit et la chanson de Curawaka (« Pacha Mama ») s’immisce délicatement dans ma tête, me donnant le dernier souffle avant l’orage.
Pas à pas sous une pluie tropicale
Un brin d’ananas dans l’une des atiendas locales et je couvre mon sac d’une poche poubelle d’un noir profond. Il nous faut affronter la pluie jusqu’au prochain camp. Je suis prête mentalement à me retrouver tremper. Ce n’est pas comme si chaque centimètre de mes vêtements étaient déjà teintés d’humidité. Nous avançons au couvert des arbres. Les gouttes passent parfois à travers le feuillage mais sont moins transperçantes qu’espérer. Le sol argileux s’épanche en légère coulée et je suis bien contente d’avoir demandé au guide un bâton pour ne pas glisser.
Tout le monde est parti devant. Carlos et les deux compagnons de route. Carlos l’interprète, lui, reste en retrait pour me laisser le temps d’adapter mes pas à la terre lisse et mouillée. Finalement, le camp se dévoile, caché au bord de la rivière. Nous sommes tous ravis d’engloutir notre diner, après notre douche quotidienne, cette fois-ci gelée.
Jour 3 : la Cité Perdue à perte de vue
Des marches par centaines
Le réveil est difficile ce matin. Quelqu’un a joué avec la lumière blanche de sa lampe torche. La nuit fut mouvementée et courte. Le départ à 6h se fait à reculons et pourtant c’est le grand jour !
Nous nous glissons sur la plage pour rejoindre le sentier étroit. La lumière matinale éclaire le vert croquant des arbres. Les marches commencent à se poser ça et là. Je sais qu’il va falloir en grimper 1200. Vue la taille des pierres, je ne sais pas si le compte est bon.
Se présentent enfin celles que l’on voit sur les photos. Je pose un pied instable, puis l’autre avec l’impression de marcher comme un hobbit avec le bâton de Gandalf : des pieds trop grands pour la petitesse des marches qui semblent glisser plus intensément au fur et à mesure de mon avancée.
Après 2-3 grosses montées, nous arrivons au pied de la Cité Perdue, aussi surnommée ‘l’Enfer Vert ». Nous ne tardons pas à comprendre pourquoi, entourés d’un nuage de moustiques affamés. Difficile alors de se concentrer sur les explications du guide.
Découverte de la Ciudad Perdida
Nous grimpons au fur et à mesure libre d’errer dans la Ciudad Perdida. Nous découvrons les pierres qui ont servi de carte dans le passé, ainsi que les espaces où se dressaient autrefois les lieux accueillant les cérémonies : un pour les femmes, un pour les hommes. Les cartes ressemblent à de gros menhirs plats, dressés à la verticale et incrustés de symboles.
La Cité Perdue aurait été construite par les Tayronas en 800 après J.-C., dont les Indiens de la Sierra Nevada seraient les descendants. Abandonnée pendant la colonisation espagnole, elle aurait été « redécouverte » par les pilleurs de tombe (« guaqueros ») dans les années 1970.
Cachée dans la jungle pendant une centaine d’années, elle était connue des populations locales. Nous rencontrons d’ailleurs le Mamo qui nous attache un bracelet blanc orné de perles autour du poignet, afin de guérir les maux que les plantes ne soignent pas (à l’image de la tristesse par exemple). Il est le chef des Kogis qui ont repris domicile au cœur de la Ciudad Perdida. Carlos nous explique que les leaders spirituels masculins représentent le soleil tandis que les figures féminines, appelées Saga, font référence à la lune.


Après cette rencontre, nous descendons au cœur de la 3ème partie de la cité, où un canal irriguait les habitations jusqu’à la rivière. Les marches de l’aller se retrouvent et nous regagnons le camp de la veille pour déjeuner. L’après-midi consiste à rebrousser chemin, descendant sur le sol orangé, espérant échapper à l’orage qui grogne au loin. Par chance, ce n’est que 3h plus tard que la pluie tombe, alors que je pose les pieds sur le sol bétonné du camp.
Une douche, un lit sélectionné et j’attends patiemment l’heure de manger, pestant intérieurement contre cette touriste qui fume sur le banc d’à côté. La nuit fut chaude, assommée par l’humidité ambiante.
Jour 4 : Dernier jour de trek au cœur de la Sierra Nevada de Santa Marta
Le jour se lève et il faut revêtir une dernière fois ces vêtements qui ne sèchent plus. L’odeur est devenue une habitude. La marche, elle, nous demande un peu plus de motivation. Les muscles fatigués s’étirent à chaque foulée. On continue à rebrousser chemin, pourtant ma tête a déjà tout oublié : le terrain glissant, les montées, les descentes. L’avantage ? Redécouvrir le parcours comme une première fois.
Je ne sais donc pas combien de kilomètres il nous reste à parcourir avant d’arriver au village. Carlos troque des feuilles de coca à chaque rencontre. Les appareils photos sont cachés lorsque nous traversons les villages des Kogis et je continue à m’émerveiller de pouvoir les croiser sur leurs terres, eux qui portent un lien sacré avec la nature, tant oublié par notre monde occidentalisé. Lorsque je découvre ces trois hommes, vêtus de blanc, assis sur des chaises en plastique en train de regarder Roland Garros à la télé, au milieu de la jungle colombienne, mes idéaux de touriste s’effondrent. Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer.
Les montées nous prennent au mental tandis que les descentes fragilisent nos cuisses déjà bien échauffées. Surpris de l’ascension du premier jour, on avance étonnés de « tienditas » en « tienditas » jusqu’à retrouver le premier camp pour un snack express. Je profite d’une micro-sieste sur un banc. Moi qui pensait que ce trek de 4 jours serait « facile », le comparant avec ma traversée des Pyrénées, c’était sans compter sur la fatigue que procure ce climat loin d’être tempéré.
12h30, c’est le graal ! Il faut affronter le soleil que la forêt cachait jusque-là. Les forces me manquent pour écrire ces lignes… Le village est atteint. Nos papilles s’émerveillent du poisson et de notre premier riz de coco, avant de faire état de nos piqures. Alexandra a gagné une infection. Mes jambes sont couvertes sur chaque centimètres et nous montons dans la Jeep, bien décidés à passer par une pharmacie à notre retour sur Santa Mata.
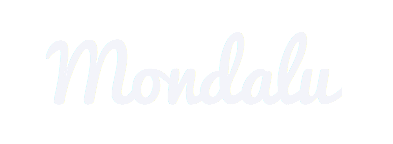


Pingback: Elle s'appelait Colombia - Mondalu