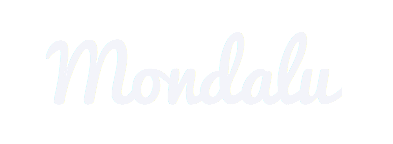Il y a des destinations qu’on n’avait pas prévu. Celles dont l’idée se glisse quand un ami rentre chez lui sur le même continent. L’hiver à Montréal qui se fait un peu trop long. Une date butoire de déménagement. Comme je n’ai jamais su faire les choses à moitié, j’y suis allée pour un sourire. Je crois qu’avec ma vie, on pourrait en écrire des livres.
Bogotà, introduction à la Colombie
Baragouinage
Mes billets sont pris. Un coup de tête. C’est comme ça qu’on appelle les décisions de dernière minute qui se prennent 3 jours avant le départ. Quelques textos échangés… la Colombie va-t-elle tenir ses promesses ?
Mon envol prend une heure de retard. Peut-être qu’il vaudrait mieux que je reste. Je n’ai officiellement plus d’appart. Va-t-on partir ? Les questions se bousculent dans ma tête, avec la certitude que quoi qu’il arrive je rebondirais sur mes pattes telle une déesse féline à poil noir. Les messages grésillant dans les hauts-parleurs me semblent incompréhensibles. Je n’ai pas pratiqué mon espagnol depuis les bancs du lycée. Je regarde les passagers interloqués : ce n’est pas mon niveau rouillé. On roule. Les ailes se déploient. Je me dis que j’aurais du rester à Montréal.
Après une nuit sans sommeil, je découvre Bogotà sous les nuages. Ce n’était pas prévu dans mon plan initial. Finalement ça tombe bien ! À peine arrivée, j’ai une visio qui m’attend. Sur les conseils de mon hôte, je prends un Uber à quelques pas de l’aéroport. Difficile de se retrouver dans les méandres des sorties. Avec un peu de patience, j’arrive au nord de Chapinero.
Je baragouine mes premiers mots au portier. Puis, il ouvre la porte.
Il est l’heure de faire une sieste et de me préparer : l’ambassade de France de Vancouver m’attend.
L’entretien passé, je respire. Un peu…
Je suis toujours chez ce grand brun aux yeux pas bleus.
Temps maussade
La pluie se déverse dans les rues de Bogotà. Pourtant je suis encore sur mon petit nuage.
Après une matinée au ralenti, j’ai pris la route de Monserrate. « Ne monte pas à pied », m’a-t-il dit. Pourquoi l’avoir écouté ? Soit-dit en pensant j’ai aussi pris le téléphérique à la descente de peur de glisser sur les pavés mouillés. La cage vitrée s’élève rapidement. Bogota s’étend sous mes yeux, bordé de montagnes verdoyantes, à 3 152 mètres d’altitude. Au sommet, je m’abrite au cœur de la basilique, construite en 1925, le temps de laisser passer l’averse. Les couleurs changent et les nuages accentuent l’horizon. Je déambule rapidement à travers les boutiques de souvenirs, à l’image d’un Lourdes religieux. J’ai hâte, hâte d’explorer le centre.
De là où m’a laissé le taxi, je continue à pied. L’envie de déambuler au hasard. J. m’a dit de faire attention. Je n’ai pas les codes. Alors j’écoute les conseils de l’habitant du coin. Mon instinct, lui, pense qu’il exagère.
De Monserrate, je passe près de l’université et je me retrouve à suivre des petits chemins de parcs en parcs. Le soleil est de la partie, éclairant gaiement les grafittis. Les nuages grossissent, alors je m’arrête au musée del Oro, réputé pour être magnifique. Puis de la place Bolivar, je tire au sud jusqu’au musée Santa Clara.



Coup de cœur pour Botero
La veille, j’avais pris l’après-midi pour humer l’air de la capitale colombienne. Sans pression, je m’étais avancé vers le musée Botero, gratuit, sans savoir ce qui m’y attendait. Je ne connaissais pas cet artiste colombien à la fois peintre et sculpteur. Né en 1932, Fernando Botero s’inspire de l’art précolombien et populaire qu’en 1957, après s’être cherché pendant ses études et ses séjours en Europe. Sa Nature Morte à la mandoline marque un tournant dans son style affirmant des formes rondes et décuplées, qui le rendra célèbre. C’est cela qui m’a particulièrement touché chez l’artiste. On se retrouve devant un chat bien plus gros que d’ordinaire, des personnages aux expressions stoïques mais grassouillets, une Joconde plus ronde que l’originale. Pas d’appel à la grossophobie, mais à une mise en perspective différente. Un moment plein de bonne humeur, suivi par le déluge ralentissant l’arrivée de mon taxi retour.
Je ne savais pas encore que je passerais mes soirées en solitaire et partirais frustrée de Bogota. Pas un brin de salsa au Galeria Café Libro recommandé par mon chauffeur du jour, ni de marche dans le quartier Quinta Camacho. Pas de dimanche à bruncher au cœur d’Usaquen que l’on devait rejoindre à vélo, les grandes artères étant fermées aux voitures chaque fin de semaine. C’est finalement à travers les fenêtres de mon taxi que je verrais les bogotanais profiter de ces moments en famille, pour ralentir, prendre possession de la ville et se créer des souvenirs.
Au nord, sous un ciel de caraïbes
Mon arrivée à Carthagène se fait en douceur, quoi que la ville a revêtu ses teintes tropicales. De 14 à 35 degrés, le coup de barre a sonné. J. vient me chercher à l’aéroport… peut-être pour se rattraper des derniers jours. Il m’emmène au cœur de Bocagrande où je suis censée passer la semaine. On est loin du charme de la ville portuaire que j’avais imaginé parmi les grands bâtiments élancés.
Je chille sous le ventilateur, assommé par la météo lourde de ce mois de juin. La mama débarque un jour plus tôt. Je venais à peine d’apprendre son arrivée. Je retarde la rencontre. Qui pourrait faire une bonne impression sans aligner deux mots d’espagnol ? Sauvée par le gong, le diner du soir au restaurant me laisse sans voix.
Découverte de Carthagène
Pour mon premier jour officiel dans la vibrante Carthagène, une visite guidée « gratuite » teintée d’humour comme je les aime, m’emmène à travers la vieille ville jusqu’au quartier de Gestemani. Il fait chaud aujourd’hui encore. Les couleurs ravivent mon cœur teinté d’illusions et j’erre de la Torre del Reloj, à la place de Bolivar avant de traverser le parc Centenario pour rejoindre la place de la Trinidad.



Grand port de l’empire colonial espagnol dès 1550, Carthagène est une étape privilégiée entre la métropole, le Mexique et le Pérou. C’est d’ailleurs de la ville que partent les conquistadors en quête de l’Eldorado… Véritable porte d’entrée des Andes et lieu stratégique, elle attise la convoitise anglaise et française. Dès 1586, les Espagnols profitent des défenses naturelles qu’offrent les nombreux chenaux de la baie pour édifier une enceinte autour du port. Classé depuis 1984 au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’imposant Castillo San Felipe de Barajas rappelle inlassablement l’histoire de la ville, signant la défaite des anglais et la fin des ambitions britanniques en Amérique du Sud. Surnommée depuis l’Héroïque, Carthagène des Indes a été la première province à s’auto-déclarer indépendante de l’Espagne le 11 novembre 1811, ouvrant la voie à tout le continent.
Le soir, c’est le bord de mer qui m’accueille avant de rejoindre la mama pour un diner dans une pizzeria
Direction Santa Marta
J. doit participer à un congrès de 3 jours et m’annonce un week-end anniversaire à Bogota, où je ne suis pas conviée. Il est temps de prendre la route pour Santa Marta et jouir d’une certaine liberté.
Déposée au bus le matin, je sieste sur les cinq heures de route qui m’attendent. C’est sans compter sur mon voisin de siège, un américano-mexicain, qui a la conversation facile. On parle des heures de tout et de rien et je me retrouve à ré-apprécier le voyage, à lâcher prise sur mes derniers jours et à profiter des dernières heures du jour pour le suivre. À peine arrivés à Santa Marta, on grimpe dans un taxi pour Taganga.
On s’offre les meilleurs jus du monde. Mon compagnon de route barbote dans l’eau alors que le soleil se couche. Je suis sur mes gardes quant à ceux qui m’entourent. Deux américaines nous rejoignent et on passe la fin de journée sur la plage, face à ce petit village de bord de mer. Elles nous encouragent à prendre le bus local et des souvenirs joyeux de Côte d’Ivoire remontent à la surface. L’air qui s’engouffre par les fenêtres inexistantes permettent d’apprécier la température chaude de ce mois de Juin. À Santa Marta, on tarde à se retrouver pour le diner du soir… du poisson frais, des patacones (banane plantain)… Je dois les abandonner alors que la soirée défile. Mon réveil sonne tôt le lendemain.

Un trek pas comme les autres
Vous pensiez que j’étais seulement venue pour une belle rencontre ? Vigilante, je m’étais noté ce trek au cœur de la jungle colombienne. Peut-être une excuse… Une échappée en solitaire pour me préserver. Un joli pied-de-nez à celle que j’étais à mon arrivée. La preuve intangible que j’ai la tête sur les épaules et les pieds bien ancrés. Qui sait…

Parcourant des terres indigènes, cette randonnée de 3 à 4 jours est seulement accessible via des tours-opérateurs. Le prix est élevé. Il est temps de se lancer. L’agence choisie me donne rendez-vous dans son bureau à deux pas de mon auberge de jeunesse. J’y suis passée la veille pour tout régler. Et bien, ce matin, on n’est pas pressé. J’attends le départ, vu qu’ils organisent le transport jusqu’au parc. Les gens montent en cours de route pour nous laisser quelques minutes plus tard. À la fin nous ne sommes plus que 5 et le chauffeur.
Une bien belle aventure nous attend. Humide et pleine de piquant !
Minca et tourista
Après 4 jours de trek, on s’attendrait à ce que je me repose. Réveillé automatiquement à 6h (à croire que les sorties en nature me transforment toujours en lève-tôt), je me dis qu’il serait dommage de trainer dans un hamac toute la journée. Me voilà dans le bus local pour Minca. Une heure de trajet plus tard, à la vue de la météo, je tente de rejoindre la cascade Oido del mundo, malgré les gros nuages foncés au loin. Ce n’est pas une petite pluie qui va atteindre ma motivation aujourd’hui, même avec l’ensemble de mes affaires sur le dos. À croire que les 60 km avalés ces derniers jours n’ont pas suffit à me faire appuyer sur pause.
Une cascade et une glace
À l’arrivée, je me surprends à tenir une conversation en espagnol avec ceux qui veulent me faire payer l’entrée. Apparemment ce n’est plus gratuit depuis le mois d’Avril. Ils ne lâchent pas le morceaux et je finis par sortir le porte-monnaie malgré mon incroyable adaptation soudaine. 5 min de descente pour rejoindre la belle cascade qui m’invite à la baignade. L’eau me nettoie de ma marche mais je ne reste pas très longtemps. Je dois encore rejoindre mon auberge avant la nuit que j’ai choisi en hauteur pour ses fabuleux coucher de soleil.



De retour au village, je tente une glace délicieuse avant de m’élancer sur la montée des marches. Arrivée en haut, la vue est belle et l’ambiance cosy à la Casa Loma. Je m’abandonne sous la douche froide, m’installant ensuite sur les sièges confortables. Le coucher de soleil ne viendra pas et mon burger vegan du soir a un goût à me faire vomir mes entrailles. Je me dis que c’est surement l’espèce de pavé au pois chiche qui sort de l’ordinaire… malheureusement le réveil et mon ventre gargouillant me donneront tord. Je suis ravie de quitter cette auberge où je n’ai fermé l’œil que très tard, bataillant avec une jeune anglaise pour la lumière et son sac. À mon réveil matinal, tout ce qui m’inquiète ce sont les 5h de bus qui m’attendent pour un retour à Carthagène, sans toilettes…
Détour à Carthagène
Je retrouve les buildings sans âme de Bocagrande et l’ambiance chill de la maisonnée. La sœur est partie me laissant sa chambre, J. bosse dans la sienne et la mama s’accommode de ses telenovas et ses heures de conversations au téléphone.
Je visite le château San Felipe de Barajas à la fraiche, me ramenant bizarrement au Ghana. Peut-être parce qu’il a été construit par quelques un des 600 000 esclaves d’Afrique, qui furent envoyés dans les plantations et les mines d’or et d’argent de cette région du nord. Du 16ème au 18ème siècle, Carthagène est une plaque tournante de la traite négrière. Si Palenque de San Basilio, à deux heures de route de là, attire aujourd’hui les touristes, c’est parce qu’il fut l’une des terres d’accueil des esclaves fugitifs et témoin en 1713 de la première communauté noire libre des Amériques.

Café et amitié
Je décide de longer la mer pour rentrer… au bord de la route principale, parfumée des pots d’échappement. Mes compagnons de la Ciudad Perdida sont dans les parages et on se retrouve pour un café bien corsé, heureux de sentir à nouveau bon. Ils m’avouent avoir enfermé leurs affaires de trek dans la valise qu’ils n’ouvriront plus jusqu’à leur retour en Suisse. De mon côté, j’ai tout passé à la machine… même mon sac. J. a dû s’accommoder de mes odeurs de chaussures, ce qui ne l’a pas empêché de m’accompagner sur mes deux dernières soirées carthagènoises. Pas de salsa, mais un roof top sympa avec une piña colada à tomber par terre, une autre ambiance dans un bar extérieur et une fin de soirée à la colombienne, en mode karaoké et enterrement de jeunes filles. Nos rires sont là… pas aussi fluides que nos premières fois.
La météo n’est pas au beau fixe depuis mon retour. Mon idée d’exploration des îles du Rosaire est littéralement tombé à l’eau. Au fond ce voyage en Colombie ne suit aucune logique, en dehors de vouloir passer du temps avec J. Me voilà donc, à nouveau, en route pour Santa Marta.
Retour à Santa Marta
Si je devais absolument finir mon voyage ici, c’est à cause du Parc national de Tayrona. Fermé deux semaines en juin (mais aussi en février et octobre) pour laisser souffler la nature et respecter les rituels spirituels des peuples autochtones, j’avais fait en sorte de me garder deux jours d’ouverture pour le découvrir.



Une rencontre couchsurfing me fait passer la nuit à l’auberge/hôtel de Bohemia Beach. L’hasard fait bien les choses et j’en profite pour ralentir. Le gérant, français, me dit confiant : « tu vas avoir la queue aux portes du parc et ce ne sera pas agréable ». Ce n’est pas le premier à ne pas me recommander Tayrona, affirmant qu’il y a bien d’autres merveilles naturelles à proximité sans aller payer ce parc naturel surpeuplé. Il me conseille néanmoins de me faire déposer à Calabazo pour rejoindre Cabo San Juan via l’ouest.
Fatiguée et peu prête à faire les 4-5h de marche recommandée avec mon sac de voyage, je pars en taxi-moto à l’aube pour arriver à l’ouverture, à l’entrée la plus connue : El Zaino. Quelques européens ont eu la même idée, mais ça semble moins pire qu’annoncé. La niaque absente, je décide de n’y passer que la journée. Je rejoins Arrecifes, tentant de doubler un maximum de touristes en tong, arrive à la Piscina et continue jusqu’à ma destination finale : Cabo San Juan. J’y aperçois le camping où la plupart des visiteurs y passent la nuit. Les hamacs sont entassés en rangs serrés et les tentes respectent leur emplacement au millimètre près.
Échappée belle à Tayrona
Terre sacrée pour les descendants direct des Taironas, je suis bien trop heureuse que le parc ferme régulièrement pour tenter de réparer ce que le tourisme de masse inflige. Depuis 2019, les zones de Chengue, Los Naranjos, Pueblito Chairama et la zone orientale de Bahia Conchas sont d’ailleurs totalement interdites aux visiteurs, afin de préserver les sites spirituels du grand public.
Dégoulinante de sueur, je plonge directement dans les eaux agitées de Cabo San Juan. À peine le temps d’enfiler mon short que la foule arrive… Je remets mon sac sur les épaules pour rebrousser chemin… en solitaire. Une pause s’impose du côté de la Piscina, où seulement quelques âmes ont eu envie de ralentir. Je me délecte de ma dernière limonade de coco et je tombe amoureuse une nouvelle fois de la Colombie.
Parc naturel national protégé depuis 1960, il abrite des espèces diverses et variées et j’ai la chance de me délecter des cris des singes hurleurs alors seule sur le chemin du retour vers El Zaïno. Un bus plus tard, me voilà à Santa Marta, parcourant ses rues animées et ses petits cafés où il fait bon se pauser.
Il y aurait tant à dire sur ce voyage en Colombie. Survolé, coloré, émotionnellement instable. Mais une seule envie : y revenir au plus vite !