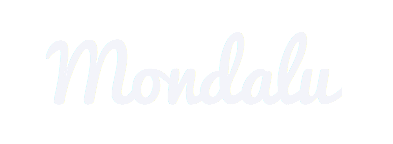Updated on décembre 29, 2024
Randonner dans les Pyrénées Espagnoles: des Encantats à Ordesa
« Ça te dirait d’aller randonner dans les Pyrénées Espagnoles ? » Un ami me propose de l’accompagner sur sa semaine de vacances. Le connaissant pour ses week-end bivouac et randonnées, je saisis l’opportunité pour aller explorer les Pyrénées côté espagnol. Originaire de Toulouse, je n’y ai jamais mis les pieds. On m’avait pourtant dit, lorsque je suis partie marcher sur le GR10, que l’Espagne recelait de petits trésors de l’autre côté de la frontière et qu’il serait dommage de passer à côté. Depuis l’envie de mixer le GR10, avec un brin de GR11 et de HRP se fait sentir, mais ce sera pour une prochaine aventure.
Randonner dans les Pyrénées Espagnoles: Trois jours dans les Encantats
Nous partons donc de Toulouse, et après seulement 3h de route, nous arrivons à Espot où commence notre randonnée. D’ Espot nous croisons les taxis qui font la navette jusqu’aux différents départs des sentiers. Nous montons en voiture jusqu’au parking le Prat de Pierro, où pas mal de personnes se sont déjà garées et où les distances de sécurité semblent aussi s’appliquer aux différents moyens de locomotion (nous sommes encore en pleine pandémie). Nous chaussons nos chaussures de randonnées qui vont nous accompagner pendant 3 jours de trek dans le Parc national d’Aigüestortes et lac Saint-Maurici. Ce parc, créé en 1955 est le seul parc national catalan. Les Encantats (« enchantés ») sont en fait deux pics rocheux jumeaux au cœur du parc, qui le caractérise. De leurs sommets respectifs, ils ne sont pas les plus hauts, mais veillent sur les randonneurs avançant entre mille lacs.
Jour 1: D’Espot à Maria Blanca via le Col du Monastero
C’est sur le chemin entre le parking et le Lac Maurici, que je découvre la légende qui les incarne. Je ne comprends pas tout avec mon espagnol hésitant. Lorsque nous apercevons l’ermitage de Sant Maurici, un panneau nous parle de deux hommes, qui auraient séché la messe ou un pèlerinage important, pour aller chasser et crapahuter dans les montagnes, et se seraient fait prendre par l’orage et pétrifier dans la roche pour les punir de leur audace. Cristòfol et Esteve seraient donc aujourd’hui le Grand Encantat et le Petit Encantat… une jolie histoire qui est censée nous rappeler que la montagne sera toujours maitre et que la nature se respecte.
Sur ces belles paroles, nous prenons une bifurcation à gauche avant le Lac Maurici pour nous diriger vers le Col du Monastero. A quelques mètres de l’embranchement, nous voilà déjà éblouis par les célèbres Encantats et le soleil. Il est déjà 12h ! Nous nous posons au bord d’un lac asséché, avant de ne continuer vers le col.
Le col finit par arriver, sableux et glissant, et j’ai bizarrement un coup de boost pour le grimper. Peut-être la joie de reprendre la randonnée après deux semaines de pause, dans des paysages fabuleux ou l’idée que je n’aurais pas à descendre ce monstre ensablé en sens inverse. Mon coéquipier me suit difficilement avec la tente et le réchaud (qu’on aura fini par prendre pour rien), puis reprend du service après le col.
La descente se fait au travers une myriade de lacs, où les eaux scintillent à travers les rayons du soleil. C’est époustouflant et je m’arrête régulièrement pour prendre quelques photos. Après le barrage, nous apercevons le fameux refuge de Maria Blanca, que mon ami m’ayant conseillé cette randonnée, qualifie comme l’un des plus beaux des Pyrénées. Il serait difficile de le contredire.
Après un brin d’étirement et de yoga avec une vue splendide, il est temps de profiter de la demi-pension obligatoire. Les yeux du gérant semblent se confondre avec l’eau des lacs environnants. Je passerai une nuit désastreuse, non pas à cause du confort ou des ronflements, mais parce que parfois en tant que femme, il faut savoir gérer certains désagréments.
Jour 2: De Maria Blanca à Colomina puis Estany Llong
Le lendemain matin, la question de continuer se pose: arriverais-je à faire l’étape après la courte nuit et mon corps en feu ? Je décide de tenter l’aventure et tout se passe pour le mieux jusqu’au refuge de Colomina.
De Maria Blanca, il faut reprendre le chemin de la veille jusqu’à la bifurcation menant au col de Saburo.
A Colomina la vue est belle. On se pose le temps de manger au refuge et de savoir s’il sera possible de dormir à celui d’Estany Llong le soir. En effet, il était indiqué complet en ligne, bien avant de partir et nous n’avions pas réussi à joindre les gérants depuis. C’est qu’au cœur du Parc national d’Aigüestortes et lac Saint-Maurici le camping et le bivouac sont interdits. Nous avions longtemps cherché l’information quant au bivouac, sans vraiment être surs que nous étions en tord si nous plantions notre tente au coucher de soleil et la plions avant le jour. Les personnes rencontrées à Colomina et tout au long du trajet, nous ont confirmés que le bivouac était interdit au sein du parc (même autour des refuges) et que nous risquions une amende de 300€ minimum chacun si nous avions la chance de tomber sur un garde. Loin de nous le désir d’enfreindre ce qui est mis en place pour protéger une nature fragile, nous avons néanmoins rencontré des randonneurs qui prenaient ce risque. Dans tous les cas, ne laissez aucune trace ! Ni papier toilette, ni peau d’orange (vu sur les chemins).
Notre demi-pension confirmée pour la soirée, nous reprenons la route encore longue jusqu’à l’Estany Llong. Le sentier longe et finit par se confondre avec le chemin de fer qui servait autrefois peut-être à amener le matériel construisant les barrages. Nous atteignons l‘Estany Tort puis commençons la descente qui finit par se faire longue jusqu’à l’Estany Llong. Le refuge se dévoile enfin… une douche, un bon repas et quelques mots en français avec nos voisins de table et ce sera l’heure de récupérer de ma dernière nuit courte.
Jour 3: D’Estany Llong à Espot
C’est la dernière journée de notre aventure dans les Encantats. Le temps a changé légèrement et les nuages se sont épaissis. Les couleurs du matin offrent une ambiance mystérieuse, sur le plateau aux vaches espagnoles. Ces dernières prennent la pause devant les ombres bleutées des sommets lointains.
Il nous reste un dernier col à gravir, celui du Portaro d’Espot. Son nom nous indique que nous sommes sur le chemin du retour et pourtant l’enthousiasme me manque. Les vues sublimes m’entrainent avec elles et je finis par avancer par automatisme vers un lac que je n’ai pas découvert à l’aller. Après le col, le Maurici s’offre à nous, grand, aquatique et imperturbable face aux promeneurs de la journée. C’est que ce lac reste accessible aux personnes à mobilité réduite, et que du parking initial il est bon de venir passer la journée muni de son pique-nique.
La descente jusqu’au parking nous semble beaucoup plus longue qu’il y a 2 jours. Nous finissons tout de même par arriver et nous reprenons la route vers notre 2ème étape, ravis de ces quelques jours dans le parc et confiants quant à la suite de notre périple. Les Encantats m’ont laissé un goût de « reviens-y » et je serais curieuse de les découvrir en plein hiver, lorsque les lacs seront recouverts de neige.
| Pour réserver vos nuits en refuge: http://refusonline.com/fr/carte-reserves-en-ligne La carte du Parc national d’Aigüestortes et lac Saint-Maurici à télécharger ici. |
Au delà des Pyrénées Espagnoles: randonnée kayak au Congost de Mont Rebei
D’Espot à l’auberge de Montfalco, il faut compter 2h30 de route en fonction de vos aptitudes à conduire sur une route non goudronnée à partir de Viacamp. Le Congost de Mont Rebei, ce sont des gorges dont les parois vertigineuses atteignent plus de 500 mètres, dessinées par la rivière Noguera Ribagorçana qui serpente au milieu des montagnes de Montsec, nous émerveillant de ses eaux turquoise. Afin de découvrir cette beauté de la nature, plusieurs points de départ sont possibles: La Pertusa, juste après le village de Corça (ou de Corça même ou Ager si vous commencez en kayak depuis la base nautique), La Masieta ou depuis l’auberge de Montfalco. Nous avons choisi la dernière option car nous pensions pousser notre découverte jusqu’aux Finestras, dont j’avais entendu parler sur le blog de Guillaume et Betty.
Nous arrivons donc à l’auberge en fin de journée, après notre troisième étape depuis les Encantats. L’impression d’être au milieu de nulle part se fait sentir et mon compagnon de route s’empresse d’aller papoter avec la gérante du coin. Celle-ci nous donne quelques pistes pour dormir et nous renseigne sur nos options kayak pour le lendemain. Nous voulions absolument faire un aller sur l’eau puis un retour sur terre, afin de profiter complètement du Congost de Mont-Rebei. Après avoir glané quelques informations, nous réservons notre embarcation pour le lendemain matin et nous nous dirigeons vers l’ermitage de Santa Quiteria, à quelques minutes de l’auberge. Ça grimpe sec, puis nous nous retrouvons en hauteur entre des murs de pierres claires, au cœur d’une église, dominant les eaux turquoise séparant l’Aragon de la Catalogne.
Nous redescendons pressés de trouver un lieu pour dormir et avare de la journée qui nous attend le lendemain. Nous dormirons au bord de l’eau sous les étoiles brillantes.
Le lendemain, nous avons rendez-vous à l’auberge d’où nous partons en voiture avec l’un des gérants, qui vient de nous équiper. De la base nautique, nous pagayons sur 7km au dessus des eaux merveilleuses de la Noguera Ribagorçana pour rejoindre La Masieta. Avec mon compagnon de route, on a du mal à se coordonner… lui hyperactif et derrière, moi plutôt calme et devant. Il a du mal à s’adapter à mon rythme zen et profond et tape sur mes pagaies régulièrement. Je ne peux que vous conseiller de prendre un kayak en solo dans ces conditions. La magie du lieu finit cependant par m’apaiser, et je ne regrette une seconde d’avoir tenté l’expérience (compter 40€ par personne). Nous avons 3 bonnes heures devant nous, alors nous prenons le temps de nous arrêter pour faire des photos, d’aller explorer les petits recoins à droite sous un pont puis de rejoindre La Masieta, où nous laissons nos kayaks et trouverons un banc au bord de l’eau pour nous remettre de nos émotions.
Enfin il est temps de rejoindre le chemin nous ramenant à l’auberge, cette fois-ci en hauteur. On vous conseille de faire la randonnée le matin, pour bénéficier de toute la fraicheur nécessaire à cette aventure… puis de rentrer en kayak lorsque le soleil tape, afin de bénéficier de l’eau à portée de main. Pour cette-fois, nous n’avions pas le choix.
Le chemin est très fréquenté. Il suffit de voir le sol poli par nos pas de visiteurs chevronnés, bien contents d’avoir pris leurs chaussures de randonnée. Il est difficile de se perdre. Nous suivons la rivière d’un coin de l’œil et apprécions la vue vertigineuse, nous laissant admirer les profondeurs des gorges. Le sentier monte et descend, la chaleur en cette fin septembre lourde, mais bien plus supportable qu’un mois d’été.
Nous retrouvons les ponts que nous avions découverts sur l’eau et nous rendons compte qu’il nous faudra beaucoup plus de temps à pieds. Nous avançons profitant d’un chemin plus facile que sur notre trek des Encantats. La vue est splendide et il est difficile de ne pas s’arrêter pour faire des milliers de photos.
Nous reconnaissons enfin le premier pont que nous avions dépassé en kayak et retrouvons les célèbres passerelles à flanc de falaise que nous avions vu de la rivière. Il faut monter quelques escaliers aux longues marches, pour finalement redescendre les passerelles pour ensuite… remonter. Ces dernières sont spectaculaires et on se demande bien comment l’homme a eu l’idée de les construire à même la roche. Il est tant de remonter jusqu’à l’auberge, la fin d’après-midi approchant. Ça grimpe à nouveau à travers la forêt et nous profitons de l’absence de soleil pour accélérer le pas. Nous arrivons enfin à la source, étonnés de trouver une poubelle remplie et accrochée à un arbre. Un sac de poubelle français… Quel honte ! Nous l’embarquons avec nous et retrouvons l’auberge de Montfalco pour une petite boisson fraiche. Quelle journée, splendide du début à la fin ! Avant que mon ami ne me parle de cette endroit, je n’en avais jamais entendu parler alors que nous sommes seulement à 3h30 de route de Toulouse !
Ravis de cette belle expérience, nous reprenons la route pour Alquezar, mon ami peut confiant à l’idée de faire la route non-goudronnée jusqu’à Finestras. En chemin, nous avons la joie de faire une jolie rencontre. Un renard a traversé la route devant nous, puis s’est assis sur le bas côté pour nous observer.
| Retrouvez ici la carte du Congost de Mont-Rebei |
2 jours dans la Sierra de Guara: découvertes et randonnées
Balade à Alquezar
Nous arrivons à Alquezar de nuit et nous nous posons dans un camping pas très loin de là. Je propose à mon coéquipier d’aller manger quelques tapas dans la ville. Il y a très peu de touristes à cette époque de l’année. Nous profitons des lumières du soir sur la ville et de la non-amabilité des serveurs du restaurant que nous avons choisi.
Nous reviendrons le lendemain à la lumière du jour pour découvrir la jolie ville et s’élancer sur les passerelles du Vero. Cette jolie balade est payante. Elle nous fait longer le Rio Vero, célèbre pour les activités de canyoning proposées dans la région. Nous descendons jusqu’à la rivière pour ensuite prendre le petit chemin sur la gauche nous menant vers une cavité. Depuis cette cavité, nous mettons les pieds à l’eau pour remonter le Vero, alternant entre les chemins du bord et la trempette de pied. Nous finissons par arriver jusqu’au petit pont de pierre romain de Villacontal, que vous verrez sur presque toutes les photos d’Alquezar. Après un pique-nique en bord d’eau, nous faisons demi-tour pour rejoindre la grotte à nouveau et emprunter le sentier menant aux passerelles. Pour éviter de faire l’aller-retour dans l’eau, il est possible d’accéder au pont via le village directement. Nous longeons donc le Vero et profitons de cette marche accessible aux petits comme aux plus grands. Les eaux semblent bien pâles après la découverte du Congost de Mont-Rebei, mais il suffit de lever la tête au ciel pour se rendre compte que les nuages ne leur font pas honneur ce jour-là.
La boucle finie, nous retrouvons le joli village d’Alquezar, qui nous offre ses petites ruelles de pierre animées. Du moins c’est ce que j’aurais espéré… l’heure de la sieste ayant sonné, les magasins ont fermé leur porte pour quelques heures, nous laissant dans un village vide mais magnifique. Nous aurions aimé profité des visites de la ville proposée par l’Office de Tourisme, mais les horaires ne collaient pas.
Nous reprenons donc la route vers la partie Ouest de la Sierra de Guara: le canyon du Mascun.
Découverte de Rodellar
Nous arrivons en fin de journée à Rodellar pour nous installer au camping situé à l’entrée de la ville. Nous plantons notre tente et partons explorer le petit village. Le temps n’est pas au beau fixe et le ciel s’est assombri. Nous savions que nous ne pourrions pas profiter de la Sierra de Guara comme nous l’entendions.
Pourtant cette région était pour moi un rêve lointain, découverte sur les brochures enflammées de la boîte dans laquelle je faisais mes premiers pas dans le monde du tourisme d’aventure. J’avais dans ma tête les images sur papier glacé des eaux turquoise espagnoles, qui serpentaient à travers des canyons profonds, nous permettant de randonner les pieds dans l’eau, profitant de glissade et de sauts.
Afin de nous réconforter face à la météo, nous poussons la balade jusqu’au Kalandraka une auberge au milieu de nulle part. Mon ami l’avait repéré en ligne et m’avait convaincu d’aller y faire un tour. Nous profitons des délicieuses lasagnes végétarienne et je suis projetée quelques années en arrière au cœur même des Blues Mountains en Australie. Le temps d’un « tinto verano » (ou vin d’été, un mélange de vin, de limonade espagnole et d’agrumes; un délice frais pour les journées ensoleillées), la nostalgie m’entraine au cœur d’une auberge de jeunesse où je travaillais et rencontrais les voyageurs s’étant donnés rendez-vous pour des journées d’escalade. J’y avais d’ailleurs fait mes premiers pas, de nuit, sur la roche munie de ma lampe torche avec deux français et un canadien. La française, monitrice d’escalade, m’avait parlé de la Sierra de Guara et de ses spots uniques au monde. Je me revois avec eux… puis mon esprit divague jusqu’en Tasmanie, où ma coloc argentine me parlait de ses sorties. De retour en Espagne, je vois défiler les adeptes à l’escalade munis de leurs baudriers, rejoignant leur joyeuse famille créée les soirs d’été. Un lieu comme j’aime, à quelques pas de la nature profonde, dans une joyeuse ambiance respectueuse et bon enfant.
Le lendemain viendra la pluie, froide et terrible. Nous n’aurons pas l’occasion de descendre dans le Canyon du Mascun, désenchantés par la météo. Nous décidons de quitter la Sierra de Guara, à contre-coeur pour moi, mais le temps n’annonçait aucune éclaircie jusqu’à la fin de notre escapade. Nous irons nous abriter en ville pour quelques heures à Huesca.
| Télécharger ici la carte du Parc naturel de la Sierra de Guara |
Détour à Huesca et les Mallos de Riglos
A 1h de Rodellar, Huesca se situe sur le Chemin de Saint-Jacques. Il suffit d’aller se balader en ville le temps d’une éclaircie, pour apercevoir les coquilles au sol. Nous marcherons du parc Miguel Servet à l’église de San Vicente el Real, pour rejoindre la Cathédrale à travers les petites ruelles enchantées. Du point le plus haut de Huesca, nous redescendrons vers la Plaza de Toros avant de passer à travers les rues marchandes de la ville qui se réveillent doucement, pour rejoindre le parking. Quelques photos de l’ancienne capitale d’Aragon et nous partons faire un crochet aux Mallos de Riglos à 45 min de route de Huesca.
Los Mallos de Riglos sont des formations géologiques que l’on peut admirer dans le petit village de Riglos. Nous nous garons en bas et grimpons les rues pour atteindre une jolie église. Les falaises de couleurs orangé sont impressionnantes et semblent changer au gré de la lumière du jour. Il est possible d’en faire le tour sur une randonnée de 2h-3h ou de s’adonner à l’escalade pour les plus expérimentés. Nous nous contenterons de la vue du village, le pluie ayant obscurci le ciel. Nous reprenons la route pour Torla, à 2h de là pour la dernière étape de notre périple, pour à nouveau randonner dans les Pyrénées Espagnoles.
2 jours à la conquête du Mont Perdu, à randonner dans les Pyrénées Espagnoles
Lorsque mon ami me parla du Mont Perdu, il semblait évoquer pour moi l’ascension impossible de l’un des sommets mythiques pyrénéens que je ne pensais atteindre seulement dans mes songes d’aventures. Les voix de mes profs de sport du collège raisonnaient dans ma tête: « nulle, nulle, nulle ». C’est marrant comme le sport collectif ne convient pas à tout le monde. En Australie, la randonnée fait partie des sports proposées à l’école.
En serais-je vraiment capable ? Toute enthousiaste à l’idée de réaliser un rêve qui me semblait si lointain, le Mont Perdu devait se faire à tout prix. Même à celui de la météo.
Nous avons passé la semaine à suivre son évolution, afin de trouver une éclaircie qui nous permettait de monter ses 3355 mètres d’altitude. Nous étions vendredi, les nuages semblaient se dissiper le dimanche.
Nous passons la nuit dans un camping à Torla, abrités dans l’un de leur refuge de pierre. La pluie est tellement puissante ce jour-là, qu’elle finit par s’infiltrer dans les murs et glisser sous la porte. Un plat de pâte plus tard, nous profitons du confort du soir pour une nuit à l’abri du torrent qui se déverse dehors, sans penser à ce qui nous attend le lendemain.
Jour 1: Du parking de la Pradera au refuge de Goritz
Nous laissons Torla derrière nous pour le parking de la Pradera d’Ordesa à 20 min de là. La pluie semble s’être arrêtée dans la nuit, mais nous savions que cette sensation serait de courte durée. Arrivés au parking, nous nous chaussons, prenons nos bâtons et nos sacs et nous aventurons dans le Parc national d’Ordesa et du Mont Perdu. Nous sommes surpris de voir autant de monde braver la pluie. Un garde nous arrête pour nous expliquer que le Chemin des Chasseurs n’est pas accessible et qu’une déviation est prévu jusqu’à la Cascade de Aripas, à cause des fortes pluies de ces derniers jours.
Bien sûr, nous avions prévu de prendre le Chemin des Chausseurs, qui nous aurait permis de faire une boucle jusqu’au refuge et de prendre un peu de hauteur sur la vallée. La ‘Faja de Pelay’ sera pour une autre fois et nous nous contentons de suivre la foule jusqu’à la première cascade.

La pluie a repris à peine le pied posé sur le sentier. Nous le savions, c’est ce qui était prévu. Je suis pourtant de bonne humeur, à un jour près de réaliser un rêve inavoué. Nous avançons sur un chemin facile et je me rends compte que la plupart des familles ne monteront pas jusqu’à Goritz. Elles sont là pour la promenade du week-end et la cascade semble à portée de main. Après l’avoir dépassé, nous montons doucement pendant quelques heures, sous la pluie, pas encore trempés jusqu’aux os, mais bien concentrés sur notre objectif. Les arbres du Bosque de Las Hayas nous permettent d’avancer entre les gouttes et nous offre une couverture naturelle jusqu’à ce que nous quittions la forêt. Doucement la vallée finit par se découvrir, immense sous nos yeux. Nous devons la remonter jusqu’à la Cascade de la queue de cheval ou Cascada de la Cola de Caballo, où la plupart des promeneurs du jour s’arrêteront.
Beaucoup moins abrités sans les arbres au dessus de nos têtes, nous avançons au cœur du cirque de Soaso. La vue à travers mes lunettes embuée est splendide. Je ne peux m’empêcher de m’arrêter. Trempée, je ne peux qu’admirer la vallée magique, dégoulinant de cascades par milliers. Nous longeons la rive gauche de la rivière Arazas. Soudain une cabane surgie au milieu de nulle part, et nous profitons de sa présence pour faire une pause repas frigorifiée. Nous échappons quelques longues minutes à la pluie battante, qui nous offre son manteau de gouttes fines et grises. Le froid finit par nous transpercer et nous reprenons notre chemin jusqu’à la célèbre cascade. Il faut compter 3h de marche entre le parking et celle-ci.
Le vert se mélange au gris profond et majestueux des montagnes et nous finissons par arriver à la Cascade de la queue de cheval. Elle semble bien porter son nom. Nous nous arrêtons seulement quelques minutes car le sentier ne s’arrête pas là pour nous. Nous traversons le pont, pour rejoindre les panneaux en face, laissant la rive gauche du Rio Arazas derrière nous. Deux choix s’offrent alors à nous: continuer jusqu’au refuge de Goritz via les voies d’escalade ou via le chemin de randonnée. Nous opterons pour le dernier.
La pluie s’est calmé et nous montons tranquillement jusqu’au refuge. Nous avons quitté les cascades et il nous tarde de nous mettre à l’abri. Nous séchons sur le chemin qui s’avère légèrement plus difficile que le chemin du bas accessible aux familles. Nous grimpons doucement et finissons par attendre le refuge, bien pressée de prendre une douche chaude. Il est possible de planter notre tente dehors après l’avoir signalé aux gardiens, mais nous choisissons le confort après une journée si humide. Une douche de 4 minutes et un chocolat chaud plus tard, nous serons à nouveau sur pied.
Dans notre chambre, nous rencontrons trois espagnols qui sont venus passer le week-end avec le même objectif que nous. Ils sont montés ce jour-là jusqu’au Mont Perdu, sans pour autant pouvoir accéder au sommet, stoppés net par la neige. Avec la pluie que nous avons eu tout le long, nous n’aurions même pas tenté une ascension le samedi. Heureusement pour nous le lendemain, il n’y avait pas de pluie prévue.
Jour 2: Du refuge de Goritz au parking de la Pradera
C’est le jour J ! Randonner dans les Pyrénées Espagnoles pour atteindre ce rêve… enfin ! Le but ultime est à portée de main. Nous laissons quelques affaires dernière nous au refuge (qui nous propose un cadenas contre une caution de 10€) et partons à la conquête du Mont Perdu. Le chemin n’est pas balisée, il nous faut donc repérer les cairns déposés ça et là pour avancer à peine le jour levé.
On commence directement par une mini session d’escalade et de franchissement d’escaliers naturels. Nous progressons rapidement. Un passage délicat nous amène à utiliser nos bras pour grimper puis après le sol friable et les cairns éparpillés, nous croisons les deux lèves-tôt de la journée qui sont partis ce matin à la frontale. Le couple nous explique qu’il est impossible d’accéder au Mont Perdu sans les crampons.
N’étant pas sûrs d’avoir bien compris dans notre espagnol hésitant (bon… je pense qu’on n’avait juste pas envie d’entendre ça), nous continuons cependant notre route, certains de croiser le groupe de randonneurs qui nous devançaient de plus près. Nous finissons par arriver à l’étang glacé, sur un chemin d’éboulis. Et là, nous croisons ceux qui étaient partis devant nous ce matin, dépités.
Nous levons les yeux et il faut bien se rendre à l’évidence: la forte pluie des jours précédents était de neige à plus de 3000 mètres. A 2965 mètres, nous voyons clairement le couloir raide de neige dure, se déversant de tout son long. Chaque groupe de randonneurs s’assoie devant le lac, admirant les trois compères qui essayent munis d’une corde d’atteindre le graal. Ils feront demi-tour. Personne n’avait prévu les crampons à cette époque de l’année. A quelques jours près nous y étions.
Doucement l’effet de légèreté qui m’avait transpercé depuis notre départ ce matin-là, se fit plus lourd. Si près du but, à quelques pas raides du sommet, nous aurions pu y être… Le Monte Perdido restera un bout de rêve accroché à la neige.
Je n’ai alors qu’une envie: retourner à la voiture et rentrer en France. Mais mon ami me propose de continuer vers le Pic du Marboré dont on parlait la veille, encore enflammés par nos idées de conquêtes. Nous poussons donc vers l’Ouest, pensant que la neige serait la même à plus de 3000 m. La veille, l’une des gardiennes du refuge nous disait qu’il était possible de rejoindre la Brèche de Roland du Mont Perdu, en passant par une vire non balisée. Nous tentons l’aventure parmi les rochers, surpris de découvrir un paysage totalement différent à quelques pas à peine du lac glacé. Nous poussons le chemin jusqu’à ce que nous ne puissions plus avancer. Nous ne sommes pas sûrs d’être sur la bonne vire et la gardienne nous confirmera que nous étions à peine plus haut. Après un casse croûte mérité, nous redescendons jusqu’au refuge pour récupérer nos affaires, admirant le fabuleux canyon d’Ordesa. Nous reprendrons le chemin de retour jusqu’au parking, beaucoup plus long que dans mes souvenirs pluvieux de la veille. C’est fou comme le mental impacte tant nos forces. De retour à la Pradera d’Ordesa, nous rentrerons en France. Je laisserai dernière moi ce rêve inachevé, qui en aura créé finalement bien d’autres.
| Préparez vos randonnées à l’aide du Géoportail espagnol |
Et vous connaissez vous ? Avez-vous déjà randonner dans les Pyrénées Espagnoles ? Certaines randonnées vous ont-elles marqué ? Avez-vous pu admirer la vue à 360° au sommet du Mont Perdu ?

Posted on septembre 11, 2020
Montpellier, le temps d’un week-end prolongé
Je n’avais de Montpellier que cette image biaisée, datant de mes années clubbing. A l’époque j’avais doucement pris confiance en moi en montant sur les podiums toulousains, où je lâchais mon corps quelques heures sur des morceaux de ce qu’on appelait la « minimale », un doux son électronique qui mêlait rythme et instrumental. De Monegros en Espagne au Time Warp à Amsterdam, j’avais du faire quelques soirées à Carcassonne ou Narbonne et c’était alors au tour de Montpellier, de nous dévoiler son caractère de « capitale du clubbing » de l’époque. Je me souviens avoir pris le tram, avoir fait du stop et avoir rejoint le coin des boîtes de nuit, où l’on trouvait l’after le plus célèbre du pays. Je n’avais donc rien vu de la ville… et mes quelques passages à la gare, en correspondance, ne m’avait laissé qu’un goût de destination prépubère où les gens viennent pour faire la fête. Je crois que j’avais cette image de ville sale, enfumée comme je pouvais l’être en soirée, marchant sur un sol poisseux où l’alcool avait malencontreusement dégouliné. Quelle ne fût ma surprise lorsque je décidais enfin de visiter cette ville le week-end dernier, soit plus de dix ans après !
Se perdre quelques heures dans la ville
Arrivée en gare St Roch, je sortais sous un grand soleil, surprise de voir autant de monde marcher dans les rues. A quelques pas à peine, me voilà au cœur du square Planchon, où le brin d’herbe et les quelques bancs donnent envie de s’asseoir, se poser et respirer à plein poumon, le temps de regarder les passants s’en allaient vers la place de la Comédie. Je les suis, faisant attention de ne pas me prendre une trottinette, qui semble avoir plus confiance en sa vélocité que les vélos eux-même. Un petit arrêt vers l’Opéra et c’est vers l’Office de Tourisme que je me dirige. Ma curiosité me traine jusqu’à la libraire Sauramps, que j’avais découverte dans l’article de Tania. Moi qui n’aime pas beaucoup les grosses librairies, celle-ci m’entraîne inexorablement de rayons en rayons, avec l’envie d’acheter tous les livres sur lequel mon regard se pose.
Mais il est temps de continuer car j’ai envie de faire le tour de la ville à pied. J’aime me balader seule dans un nouveau lieu, laissant mon instinct choisir la prochaine rue.
C’était sans compter l’appel de ma tante qui me propose de la retrouver place de la Comédie, alors que je commençais à peine à m’engouffrer au cœur du Corum. Volte face, c’est donc dans les quartiers Saint-Roch, Saint-Anne et à travers les ruelles de l’Écusson que nous déambulons le reste de l’après-midi.
Je me retrouve alors au milieu d’une ville ensoleillée, dont les murs jaunes pâles accueillent doucement chaque rayon de soleil. Les rues sont animées, avec leurs petites boutiques et leurs cafés. Ce n’est pas comme à Toulouse où tout paraît concentré sur quelques lieux. Ici chaque coin de rue semble vivant et on a envie de s’y promener longuement, pour en absorber chaque instant. Que c’est agréable de pouvoir marcher sans voiture ! Nos yeux peuvent alors se concentrer sur les petits détails, les plantes posées ça et là, et les murs en trompe l’œil. Je suis agréablement surprise par la ville et m’imagine même y vivre… cela le temps d’un après-midi.
Le soir, je pars faire un tour à la promenade du Peyrou, espérant trouver le soleil couchant. Je rejoins mon amie et nous irons prendre un verre à la Casa Cubano, qui offre tous les vendredis soirs une soirée salsa… mais c’était sans compter sur la COVID.
Montpellier et ses musées
Le lendemain, je propose à mon amie d’aller faire un tour au MO.CO. Hôtel des Collections, car ils ont une exposition sur l’Amazonie. Pour la petite histoire, j’ai rencontré cette fille lors de mon expatriation en Côte d’Ivoire, notamment autour de la forêt de Taï. On avait donc envie de se plonger dans une expo nature, au cœur des odeurs et couleurs d’une forêt primaire. Ce musée qui se trouve dans le prestigieux hôtel particulier Montcalm, non loin de la gare, est ouvert depuis 2019 (à ne pas confondre avec le MO.CO. Panacée donc). Il propose des expositions temporaires dont l’entrée est gratuite pour les demandeurs d’emploi (8€ pour les autres en 2020).
Nous sommes arrivées sans le savoir, au moment où une visite guidée gratuite était proposée. Celle-ci fut passionnante et les quelques œuvres choisies et expliquées, exquises. Les tableaux ci-dessous m’ont particulièrement marquée. Ils représentent tous les deux l’Amazonie. Le premier montre que même si on souhaite la contrôler ou la mettre dans une « case », la nature reprend toujours ses droits. Je trouvais que c’était une belle référence à l’être humain également. Le deuxième tableau a été dessiné au charbon. Derrière cette végétation dense et magnifique, on découvre en s’approchant des dessins connus, de personnes combattant, rappelant que l’Amazonie a toujours été un lieu de lutte, que ce soit pour les peuples y vivant, ceux l’exploitant et le fait que géographiquement la forêt se trouve sur plusieurs pays.
En sortant (ou en entrant) du musée, on se retrouve dans un Jardin des Cinq Continents, où l’envie de se poser persiste. On finira par prendre la direction du jardin botanique, afin de profiter d’un petit goûter au Coffee Club, rue St-Guilhem à quelques minutes des meilleurs odeurs de café de la ville (au Café Solo).
Le lendemain matin, j’irai faire un tour au Musée Fabre, plus classique, qui est gratuit tous les premiers dimanches du mois.
Le jardin botanique de Montpellier
Pour bien finir notre journée, c’est au Jardin Botanique que nous faisons un tour. Je ne suis jamais très fan de ces jardins… car je les trouve souvent trop bien organisés ou trop peu exploités. Je garde précieusement les souvenirs du magnifique jardin botanique de Singapour, et depuis les autres sont souvent que de pâles copies. Nous voilà néanmoins, déambulant au cœur du plus ancien jardin botanique de France ! Et je trouve que sa vieillesse lui offre un côté moins aménagé qui ne manque pas de charme. De l’ancien observatoire aux nénuphars géants, des fleurs orangé et plantes médicinales, nous arrivons devant ce vieil Oranger des Osages (photo à droite ci-dessous).
Le jardin des plantes a été fondé en 1593 et fait partie intégrante de la Faculté de Médecine de Montpellier, adjacente. A l’origine destiné à la culture des plantes médicinales (qui servaient à l’enseignement), le jardin est vite devenu un outil d’étude botanique, avec l’intégration de plantes exotiques. J’en suis repartie conquise !
L’ Université de Médecine de Montpellier, qui a fêté ses 800 ans le 17 août 2020, est la plus ancienne du monde occidental encore en activité. C’est en 1181 que le seigneur de Montpellier, Guilhem VIII, accorde le droit d’exercer et d’enseigner la médecine à tous. C’est d’ailleurs au cœur de ses bâtiments historiques que l’on trouve le Conservatoire d’Anatomie et le Musée Atger (que je n’ai pas eu le temps de visiter). L’ histoire nous dira même que Rabelais, Rondelet ou encore Nostradamus l’ont fréquenté !
En plus d’être le berceau de l’enseignement de la médecine, Montpellier (construite au Moyen-Âge) était le principal port d’entrée des épices en France au XIIIe siècle.
Montpellier et les plages alentours
On le sait maintenant, Montpellier est géographiquement bien situé. Dans le sud de la France, à quelques coups de pédale de la Méditerranée, Montpellier offre des escapades variées à ceux qui veulent prendre le temps. A l’Est de la jolie petite ville de Sète, à l’Ouest du Parc naturel Régional de Camargue et au Sud du Parc national des Cévennes, Montpellier a le goût des villes où on aurait envie de revenir pour redécouvrir les trésors cachés de son enfance, lorsqu’on parcourait les routes de France, petite en camping-car avec ses parents.
A défaut de pouvoir aller aussi loin le temps d’un week-end, nous avons opté pour l’option plage que je n’avais pas vu de l’été. Nous avons mis un moment à nous décider car la variété des plages semblait à la clé. Palavas-les-Flots est certainement la plus proche et donc la plus facile d’accès. J’en avais une image de plage « construite et bétonnée » et la photo de gauche peut le confirmer (Palavas au loin derrière les dunes). Mon amie me parlait de la plage du Pilou à Villeneuve-lès-Maguelone, petite, jolie et accessible en bus + vélo l’été. L’ offre n’étant plus valable début septembre, nos cœurs penchaient pour la plage des Aresquiers, accessible en bus et celle de l’Espiguette où il faut prendre le bus jusqu’à Grau-du-Roi puis marcher 1h pour y accéder, une fois l’été passée.
Nous décidons de partir à l’assaut de la plage de l’Espiguette, rejoignant des amis véhiculés au Grau-du-Roi. Nous prenons le tram n°1 jusqu’à Place de France puis le bus 606, nous laissant au Centre hélio marin. Ce dimanche – là, le bus était plein… ni une ni deux, mon amie appelle l’Office du Tourisme afin de savoir qu’en arrivera le prochain, et le chauffeur qui nous accueille nous explique qu’il est venu suite à notre appel. Sans ça, on aurait surement attendu 2h… Comme quoi, n’hésitez pas à les contacter si vous êtes plusieurs personnes à attendre.
La plage de l’Espiguette fait partie du Grand Site de la Camargue gardoise. Du parking, il faut encore marcher une centaine de mètres pour accéder à la plage, longue de dix kilomètres. Il y a encore un peu de monde en fin de journée, mais la plage est assez grande pour se trouver une place éloignée. C’est ça qu’on était venu chercher: une plage encore sauvage, une eau fraiche, tout ça loin des immeubles dénaturalisant souvent les bords de la Méditerranée. De nombreux kife-surfeurs profitent des vagues et du vent. Ce dernier est frais… On le sait, c’est déjà la fin de l’été.
Petit stop à la plage du Grand Travers au retour vers Montpellier
Petit stop à la plage du Grand Travers au retour

Updated on décembre 29, 2024
Randonnée secrète au cœur de l’Ariège sauvage
Août 2020.
Il y a des randonnées au fin fond de l’Ariège dont on tairait bien le nom.
Un week-end bivouac improvisé à la dernière minute, alors que tu es déjà partie en rando deux jours avant.
Une connaissance qui a crapahuté dans le coin, un lieu que l’on reconnait pour y être venue quelques semaines avant, un brin plus bas, coincés par la transhumance.
Les petites fleurs aux couleurs pastels se dérobent sous nos yeux aguerris et curieux.
On se lance sur un chemin balisé de gros points orange pourtant discrets, à travers les rochers plantés ça et là et un brin de boue au milieu.
On descend sur le flanc de la montagne dont on arrache quelques touffes d’herbes, malgré nos pieds virevoltant à droite puis à gauche pour éviter de se tordre une cheville ou de glisser en contrebas.
On se rêve à danser avec nos sacs plus lourds qu’à l’accoutumée, on prend le temps de se poser au bord de la rivière, éclipsant un instant la chaleur torride d’une journée caniculaire.
Une longue pause, certains se laissant sécher au soleil, puis on repart d’un pas plus précis qu’à 11h.
On a encore du chemin jusqu’à notre cabane de hobbit, qui se laisse fondre dans le paysage avec son toit végétal.
On zigzague à travers les herbes basses et marécageuses. On ne manque pas d’offrir un bain de boue à nos chaussures, celles qu’on avait fraichement lavé après notre dernière aventure.
On finit par arriver, comme au creux d’un cirque, tout poisseux mais heureux de cette belle échappée.
Les habitués de Massat ont déjà pris possession des lieux. Ils nous piquent à coup de mots, nous accueillant malgré eux dans leurs cœurs ariégeois. C’est qu’on est cinq toulousains sur six.
On installe nos tentes, un brin en avance pour aller profiter de l’étang plus en haut. Deux seront déjà partis au pic, tandis que nous avançons sans chemin mais avec un chien, 200 m au dessus.
L’ étang nous accueille à bras ouverts parmi les bébés grenouilles du bord de rive, seuls au milieu des montagnes. L’ eau fraiche nous rembobine. On serait presque prêt à repartir pour une seconde étape, mais la raclette nous attend. Avec 24 kg sur le dos, notre guide du jour nous a porté quelques patates et une bouteille de vin blanc.
On papote, on laisse chauffer la braise tandis que le fromage s’étale de tout son long dans la gamelle.
On profite de cake salé et brownie maison, de banana bread et autres provisions.
On éteint nos torches tandis que les étoiles prennent place à travers les nuages.
On se réveille au son des voix ariégeoises. On sort doucement de nos rêveries avec un thé bien chaud, avant d’aller ranger nos affaires. On peste intérieurement contre un départ tardif, car on sait au fond que l’orage s’en vient dans l’après-midi. C’est marrant comme l’intuition en pleine nature prend tout son sens, mais l’effet groupe aura souvent raison d’elle et c’est vers 9h30 que nous décidons d’aller voir un autre étang.
Le chemin est vague et on finit par s’aventurer hors sentiers parmi les fleurs et senteurs épicées. La pente s’élève à 60° et on regardera le ciel s’épaissir de nuages foncés, avant de ne faire demi-tour brusquement sans concertation.
C’était sans compter la brebis aventureuse, un de nos acolytes qui a choisi de s’aventurer seul sur un autre versant afin de nous retrouver à l’étang.
Inquiétude, rafraichissement au cœur du torrent, retour à la cabane dans l’espoir de retrouver notre camarade. Le ciel s’assombrit et l’orage finit par s’avancer, grondant au loin qu’on n’y échappera pas.
La cabane est maintenant vide. On s’y émisse lentement, comme contraint à prendre l’abri cherchant à éviter la pluie fulgurante qui s’annonce. Ce sera la grêle qui fera teinter la tôle, le toit végétal absorbant les chocs.
Puis surviendra au milieu de nulle part, notre camarade trempé de la tête au pied, qu’on aurait bien voulu engueuler. Mais le soulagement finira par prendre le dessus et on reprendra la route à la prochaine éclaircie… ah non, finalement sous la pluie, le tonnerre s’éloignant plus loin.
Le retour fut plus long que prévu, la montée à flanc de montagne glissante. On aura perdu l’envie de danser au cœur des montagnes ariégeoises, ne souhaitant qu’arriver en haut de la piste où nous avions garé nos voitures.
La concentration est à son maximum, le silence nous suit, la montagne grondant au loin, nous engueulant presque d’avoir été aussi téméraires face aux éléments.
On s’octroie un pot Aux Cabanes, puis un restaurant en terrasse pour finir en beauté cette riche aventure. Aux sabines et à toutes ces figures féminines, la terre mère nous réserve encore de belles surprises.

Updated on décembre 29, 2024
Randonnée dans les Pyrénées: Les lacs de la Vallée du Lys
△ 17 km / 1400 m + et 1340 m – / 10 h en boucle avec pause / TRACE GPX
Comment rejoindre la Vallée du Lys ?
Après avoir rejoint Bagnères-de-Luchon en covoiturage au départ de Toulouse, nous suivons la route vers Hospice de France (D125). Nous bifurquons ensuite à droite sur la D46 vers la Vallée du Lys. Trois kilomètres plus tard, nous continuons tout droit pour trouver une auberge et un parking rempli de voitures, laissant la route qui monte à Superbagnères.
Je suis assez surprise par le nombre de randonneurs au départ de cette boucle de 17 km. Certains ont pris leur sac de couchage et leur tapis de sol pour passer le week-end prolongé en altitude. D’autres décident de faire un aller-retour jusqu’au Lac Vert, premier lac sur le sentier. Je n’avais pas vu autant de monde randonner depuis ma traversée des Pyrénées-Orientales sur les chemins de la Carança. C’est peut-être l’effet du « déconfinement » ou seulement un chemin réputé dans les Pyrénées. Je n’avais pourtant jamais entendu parler de la Vallée du Lys jusqu’à présent, mais son nom ne m’inspirait qu’un délice poétique peuplé de lacs.
Randonnée en boucle dans la Vallée du Lys
Du parking au Lac Vert en contre-bas
Nous quittons le parking, à 1140m d’altitude, pour rejoindre le chemin balisé qui monte au Lac Vert, indiquant le refuge du Maupas. Nous commençons au cœur d’une prairie pour finalement monter en lacet dans une belle forêt de hêtres. Après 2 mois sans sport, la reprise est tendue et je me répète que la première demi-heure est toujours la plus dure, pour m’encourager.
Nous finissons par arriver au pré de l’Artigue, que nous traversons en prenant à gauche toujours en direction du refuge (laissant le Gouffre de l’Enfer à notre droite). Après un petit bois, nous apercevons nos premières cascades. Je suis souvent très enthousiaste à l’idée de faire des randonnées au bord l’eau, me replongeant en enfance lorsque je traversais les rivières sautant de cailloux en cailloux. Le bruit de l’eau appelle souvent chez moi à une déconnexion totale. Le chemin est d’autant plus splendide avec la variété de fleurs que nous trouvons au fur et à mesure de notre avancée.
Au niveau de la bifurcation de la Coume, à 1680m, nous laissons le chemin partant à gauche par lequel nous reviendrons, pour poursuivre à droite vers le Lac Bleu et Célinda. Puis vers 1950m, un nouveau croisement nous amène à prendre à droite en direction du refuge de Maupas. Quelques lacets serrés, et c’est après une station de pompage que nous laissons le sentier qui mène au refuge, pour partir à gauche sur le sentier des lacs.
Les sommets enneigés se dessinent au loin, mais pourtant la neige semble plus proche que prévue. Le Lac Vert s’admire en contre-bas nous promettons une belle pause dans quelques pas. Nous n’y descendrons pas. Avant d’entamer la descente vers le Lac Bleu, où nous pensons trouver du monde, nous décidons de rester à 2300m avec une jolie vue sur l’horizon, pour un pique-nique bien mérité.
Lacs et névés
Nous descendons ensuite jusqu’au Lac Bleu, en passant une crête rocheuse équipée d’une main courante. Le Lac Bleu s’observe depuis le petit barrage mais ce dernier n’est pas si bleu que ça ce jour-là. La glace y ajoute ses teintes blanches et joue avec les transparences. C’est splendide mais il est tant d’aller affronter le long névé que nous pouvions observer depuis notre base de pique-nique.

Nous aurions pu faire une boucle plus petite en redescendant via le Lac Vert que nous voyions au loin, mais nous décidons de continuer malgré tout en testant la neige. Celle-ci est molle en cette fin Mai 2020, mais les randonneurs que nous croisons sur notre route, nous confirment que l’aventure est possible.
Nous traversons donc le barrage juste en face du Lac Bleu et suivons le sentier qui monte légèrement à gauche du lac. La traversée du névé, sur cette zone escarpée, se fait doucement et sans encombre, finissant en beauté sur la crête nord du Pic de Graués.
Sur les flancs du Pic de Graués, nous avons tout loisir d’admirer le Lac Vert en contre-bas, dont l’imagination pourrait faire penser à un cœur. Il porte en tout cas bien son nom avec ses couleurs vertes, tachetées de bleu, accompagnant les nuances du fond de la vallée.
S’en suit un léger sentier en descente pour rejoindre le Lac Charles. Du lac Charles, encore plus blanc que son confrère, nous poursuivons sur un sentier à flanc avec un autre joli névé. La traversée se fait avec beaucoup d’attention et nous finissons par atteindre le Lac Célinda après une légère montée.
Nous prenons une pause à son niveau, admirant le blanc intact au loin. Le bruit d’un gros moustique (drône volant au dessus du Lac Célinda) ne nous permettra pas d’apprécier les lieux à leur apogée et nous décidons d’écourter la pause car il se fait déjà tard. 16h… la descente nous attend.
Chemin retour via le Col de Pinéta
Du Lac Célinda, il nous reste encore 6,5 km et 1260m de dénivelé négatif afin de rejoindre le parking. Après les passages dans la neige que je n’apprécie jamais trop, mes jambes en compote se demandent comment elles vont bien pouvoir descendre pour rejoindre la vallée. Je me prends à rêver de parapente, mais mes co-équipiers du jour ont déjà pris le sentier partant du lac vers le Nord-Est et semblent déjà loin sur la crête. La vue y est splendide, mais par manque de temps l’appareil photo restera au fond du sac sur toute la descente.
De la crête nous poursuivons à gauche pour rejoindre le Col de Pinéta. Le sentier est bien marqué et il suffira de le suivre jusqu’au Vallon de la Coume. Mes pieds se suivent, jonglant avec les roches puis dévalant doucement les dénivelés forcés.
De sentier carné en lacets, nous laissons le chemin qui mène au Lac Vert à notre gauche (vers 1930m d’altitude), pour poursuivre à droite vers la cabane de la Coume. Juste avant de l’atteindre, je m’octroie une pause avec l’une des randonneuses du groupe, où nous parlerons de voyage en Inde au milieu des montagnes, une pomme et des raisins secs à la main. Avec ma démarche cavalière, nous reprenons la route pour bifurquer à droite avant même d’atteindre la cabane, rejoignant le même chemin qu’à aller. Nous laissons le bruit des ruisseaux derrière nous, pour retrouver un sentier en pente légère à l’ombre des hêtres. Le torrent frais au niveau du parking finira par revigorer nos pieds fatigués.
Ce fût une bien belle boucle au cœur de la Vallée du Lys, que je ne recommanderais pas forcément pour une reprise. On est bien là sur une randonnée sportive, et il faudra prévoir un plan B si jamais vous n’êtes pas à l’aise sur des névés d’une fin de printemps. Cette randonnée à la journée doit être encore plus fréquentée en été, la présence des lacs incitant à la trempette de pieds ou à la baignade. N’oubliez pas de vérifier la météo avant votre départ et d’opter pour le système des trois couches. On prendra aussi encas et eau sur le départ. Belle rando !