Lorsque j’ai demandé mon visa pour l’Angola, il fallait que je puisse prouver que j’allais quittais le pays à une date précise. Je ne me voyais pas acheter un « faux » billet d’avion comme certains sites le proposent, mais je n’avais pas envie non plus de quitter le pays par voix aérienne. J’avais vu un reportage sur Sao-Tomé un jour qui se targuait d’avoir le meilleur chocolat du monde. L’idée fit son chemin et je m’étais renseignée afin de savoir s’il était possible de rejoindre cet archipel, planté au cœur du Golfe de Guinée, en bateau. La réponse semblait négative au vue de la trajectoire des containeurs qui partaient du nord au sud et les embarcations qui pouvaient être sujettes à piraterie. Le climat international commençait à devenir flou sur les chaines nationales européennes et je mettais mes responsabilités écologiques de côté pour m’envoler de l’Angola jusqu’à Sao-Tomé.
Des débuts chaotiques
Je me souviens avoir pris un taxi de nuit pour l’aéroport de Luanda. J’étais triste de quitter ce pays où je me sentais comme chez moi, sans pour autant en maitriser la langue. Le vol fut rapide, le passage à la frontière également et le visa gratuit pour une quinzaine de jours fut tamponnée rapidement. On ne m’a même pas demandé la preuve d’un vol retour… si j’avais su, je ne me serais pas précipité la veille du départ pour le réserver (spoiler: il ne me sera jamais remboursé). J’arrivais donc tard le soir, vers minuit. Il était dimanche ou peut-être lundi. J’avais contacté le seul couchsurfer du pays, qui m’avait proposé de me récupérer de nuit. A peine sortie de l’aéroport, trois personnes me firent signe de la main. Je m’approchais et rencontrais F. l’italien, sa copine française et un ami à eux français également. Ils m’accueillaient chaleureusement et le couple m’embarqua à une demi-heure de là dans leur nouvelle maison.
J’avais quitté la chaleur supportable de l’Angola, pour me retrouver dans l’humidité Sao-Toméenne. Mon esprit vagabonda une année et quelques mois en arrière, lorsque je faisais mes premiers pas en Côte d’Ivoire de nuit sous une chaleur étouffante. Sur la petite île, ça aurait pu être la fièvre, la tête embrouillée depuis que mon hôte luandaise était tombée malade. Je m’endormis rapidement, bien trop faible pour penser à quoi que ce soit.
Le lendemain, je me prépare un petit-déj tandis que mes hôtes sont déjà au travail. La française vient me voir et me demande mon programme de la journée. Je suis tellement fatiguée par ce rhume qui se présage que je lui dis que je prévois de faire quelques courses et de partir humer l’ambiance de la capitale. Elle m’accompagne, mais je la sens mécontente et stressée. On fait nos emplettes, je change mes sous dans la rue et je décide de rentrer avec elle. Premier jour à Sao-Tomé et j’ai le sentiment d’être un boulet pour mes hôtes. Je leur propose de cuisiner un truc, ils refusent gentiment. L’italien doit passer à l’hôpital faire un test de paludisme car il a de la fièvre depuis quelques jours et se sent patraque. J’en profite pour me poser derrière l’ordinateur pour faire les recherches que je n’ai pas pris le temps de faire plus tôt, espérant retrouver ma forme olympique. Ils rentrent alors avec un masque sur le visage. F. n’a pas le paludisme et sous-entend qu’il a peut-être la COVID. Nos contacts ont été limités. Ils veulent que je parte. Je leur demande si je peux rester au moins ce soir, le temps de me retourner.
Le surlendemain je pars au centre ville, après avoir contacté leur ami français pour le rencontrer. Je suis crevée, je n’ai pas la force de trouver une solution d’urgence pour ces prochains jours. J’ai juste envie de dormir, de boire du thé et de rester enfermée devant un ventilateur toute la journée. Le français est sympa, il me rappelle ce militaire rencontré un soir de festival à Montpellier. Il me propose de passer chez lui pour le déjeuner, afin que je rencontre les enfants qu’il accueille à la journée. Je me laisse guider, profite de ce moment sans penser à la suite. Le français me dit qu’au pire il peut me prêter une chambre le temps que je me décide et je lui propose un coup de main pour son site Internet en échange. Le deal est scellé pour le lendemain.
Le soir je déménagerais en urgence dans un hôtel du coin, après un au-revoir furtif auprès de mes couchsurfers. La culpabilité m’envahit. Etais-je si peu sympathique pour qu’ils réagissent de cette façon ? Est-ce le stress de la saison qui jouait en ma défaveur ? L’ambiance électrique d’une fièvre inconnue, le début d’une pandémie qui profilait son aura ? Je ne le saurais pas.
Sao-Tomé et la route du nord
Avant d’emménager chez le français, je laisse mes affaires à la réception pour partir en excursion avec une agence locale. C’est une amie angolaise qui m’avait passé le numéro du guide. D. parle anglais et nous nous retrouvons à l’hôtel où il me récupère pour partir sur la route du nord.
Nous roulons jusqu’à Ponta Fernao Dias pour ensuite rejoindre Morro Peixe par les petites routes de sable. De Morro Peixe, nous rejoignons Lagoa Azul pour nous baigner. L’île de Sao-Tomé offre à cet endroit un bout de terre enclavé qui dessine un lagon naturel de ses eaux turquoise. D. me dit de faire attention aux oursins. Il m’avoue avoir oublié le masque et le tuba pour me faire profiter des fonds marins. Je plongerais dans les eaux délicieuses pour nager un instant, puis sortirais pour gouter la bière locale et discuter avec les artisans. Je leur explique dans mon « portugnol » hésitant que leurs œuvres sont magnifiques, mais que je prévois de remonter la Côte Ouest africaine, afin de rejoindre la Côte d’Ivoire avec un petit sac pour seul compagnon. Déçus, ils décident de m’offrir un souvenir de Sao-Tomé pour que je n’oublie pas mon voyage dans leur doux pays. Comment le pourrais-je avec un peuple si généreux ?
Séchés, nous filons jusqu’à Neves, où il est temps de goûter la spécialité du coin: le crabe du restaurant Le Santola. L’endroit ne paie pas de mine pour un occidental et pourtant, d’expérience, je sais que c’est dans ce genre de lieu que l’on trouve la meilleure cuisine. Nous montons à l’étage de cette belle maison colorée pour nous installer sur l’une des tables vides. Les crabes nous sont servis avec de petits morceaux de pain aillés, accompagnés de marteaux en bois légers pour accéder à la chair de la pêche du jour. D. m’explique comment faire et m’impressionne par sa dextérité. Il a déjà fini son crabe que je suis à peine entrain de commencer le mien. Il rigole gentiment et attend que je finisse.
Après cette pause exquise, nous continuons sur la route qui mène à Santa Catarina. D. me montre le monument marquant la découverte de Sao Tomé puis m’initie à la Roça de Diago Vaz, avant de rejoindre le tunnel, où notre balade s’arrête. Nous n’irons pas jusqu’au bout de la route, ni marcher vers la Cascade de Ponta Figo. Cette journée fut une belle introduction à la petite île, mais je reste sur ma faim. Il est temps de rejoindre mon nouveau colocataire et de récupérer un moment.
Que faire à Sao-Tomé, la capitale ?
Entre temps, mon vol reliant Sao-Tomé à Abidjan s’est vu annulé (le Ghana ayant fermé ses frontières). Je prends contact avec la Consule sur place pour avoir écho des directives françaises. Quelques heures plus tôt les messages affluaient me disant de rentrer au plus vite (Macron ayant fait son fameux discours relatif au 1er confinement). Dans un pays où le mot d’ordre est « leve, leve » (doucement doucement), le stress de mes amis français finit par me gagner. Essayant de faire la part des choses, je pars en matinée explorer la capitale à pied, afin de prendre le temps de contempler, de souffler, de profiter de l’océan et des embruns salés. Je décide de rejoindre le musée de la ville en passant par la cathédrale et l’espace Cacau, où je découvre une exposition d’art magnifique et des panneaux explicatifs sur l’histoire du Cacao.
Marcher me fait du bien et j’avance pensive vers le musée national, mêlé au Fort de Sao Sebastiao (St Sébastien). Un gamin m’interpelle. Il me parle avec un grand sourire. J’ai le cœur lourd. Je lui dis que je veux visiter le musée. Il me demande d’où je viens et ce que je fais ici. Je ne parle pas portugais, il connait quelques mots de français. Il mène la conversation avec fluidité et son énergie positive débordante me requinque. Je finis par le suivre au cœur du musée, où il m’explique à demi-mot ce qui s’y trouve. A la fin je dois me décharger de 50 dobras pour régler ma visite. Il me présente alors à une jeune femme qui est – je le comprendrais quelques minutes plus tard – la guide officielle. Je n’ai plus le temps pour la suivre et revisiter les différentes salles du musée. Je dois rentrer rejoindre le français qui m’attend pour le repas du midi avec les enfants, dont il s’occupe. Le gamin s’avère être plus âgé que je ne le pensais. Il me dira à nouveau qu’il peut m’emmener dans le sud. On échangera nos numéros pour convenir d’un itinéraire, si jamais je décidais de rester.
Je passerais l’après-midi à jouer aux échecs avec les gosses accueillis par le français. Je me fais battre à pleine couture et en profite pour peaufiner mon portugais. Mon nouveau vol conseillé très fortement par la Consule, pris pour rentrer en France, se verra annulé. Je ne sais combien de temps je vais rester à Sao- Tomé.
Sao-Tomé et la route du sud
Je décide alors de recontacter ce jeune homme rencontré au musée, M. On a tout prévu: l’itinéraire, la moto, le casque et le coût de ces deux jours vers le sud. Le français insiste pour rencontrer M. et me confirme alors que je peux partir en toute confiance. Nous quittons la capitale pour la route longeant la Côte Est, jusqu’à la pointe méridionale de l’île paradisiaque.
1er jour: de Sao Tomé à Porto Alegre
Nous faisons notre premier stop au cœur de la roça Agua Ize, puis au niveau du Boca do Inferno ou « bouche de l’enfer ». Nous continuons plus au sud pour rejoindre Sao Joao dos Angolares et sa magnifique vue sur les hauteurs (il parait qu’on y mange bien). Enfin c’est au tour de la cascade de Pesqueira, avant de rejoindre Malanza pour un bon repas. Nous y rencontrons Suzanne qui nous cuisine de fabuleux poissons braisés avec du bon pain de fruit, puis nous lui promettons de revenir le lendemain. Nous passons l’après-midi à rouler de plages en plages, de Praia Cabana, à Praia Ilhame jusqu’à Praia Piscina où nous nous baignons. L’ eau est fraiche et la mer agitée. Je suis rincée par ces heures de route en moto, il est temps de rejoindre mon hébergement du soir sur la plage de Jalé, où se trouve l’écolodge au même nom. Celui-ci est complet, mais ils ont une tente à me prêter, qu’ils planteront à côté de celle accueillant les bénévoles de l’association Marapa qui s’occupent de la protection des tortues de mer sur place. M. repartira à Porto Alegre pour la nuit et me certifiera qu’aucune sortie d’observation n’est organisé ce soir-là. Le lendemain j’apprendrais que les bébés tortues avaient finalement été relâchés dans la nuit.
2ème jour: l’île de Rolas
Un nouveau jour s’offre à nous et nous avions prévu de rejoindre l’île de Rolas. Accessible depuis l’écolodge de Jalé (pour 375 dobras en 2020) ou depuis l’écolodge de Praia Inhame (pour 250 dobras si vous êtes clients ou 300 dobras si vous venez de l’extérieur et êtes moins de 4 personnes), M. m’emmène à Porto Alegre pour aller directement négocier avec les pêcheurs. Ces derniers nous embarqueront pour 250 dobras. La traversée est splendide. M. décide de sauter du bateau en plein océan pour le simple plaisir de nager dans cette eau limpide. J’ai alors l’image du bonheur a l’état pur: celle d’un jeune homme tout sourire qui profite de la nature, riant seul aux éclats face à mon visage ébahi. On le laisse nager un peu avant qu’il ne remonte dans le bateau. Nous finissons par arriver et le conducteur nous accompagne le temps de notre montée vers le « centre du monde« . Après avoir bu quelques noix de coco fraiches, j’admire la carte faite de mosaïque à mes pieds. M. m’explique que le méridien de Greenwich et la ligne de l’équateur se retrouvent ici. Le symbole est beau et la vue sublime, je m’y sens bien. M. me fait rebrousser chemin au cœur de la forêt et m’entraine vers la plage. L’ autre jeune rejoint son bateau et nous promet de venir nous chercher dans quelques heures. Nous sommes presque seul sur la Paia Café où un couple se fait servir son déjeuner. Il ne manque que le masque et le tuba pour profiter de ce lieu splendide. Je suis beaucoup moins sensible aux plages qu’aux montagnes et pourtant l’île de Rolas me dévoile l’une des plus belles plages intimistes que j’ai pu découvrir jusque ici.
Nous finissons par quitter l’île pour retourner vers la ville de Sao-Tomé et retrouvons Suzanne qui nous a encore préparé un succulent repas. Cette fois accompagné de riz, son plat me tiendra pour toute la journée. 200 dobras pour 2 personnes… et une joie communicative qui n’a pas de prix. Après ce repas, ils insistent tous pour que je prenne une douche: « mais si, après la plage tu seras plus à l’aise ! ». Gênée, je finis par accepter l’offre de Suzanne, heureuse de pouvoir me faire sentir à la maison. Un seau rempli d’eau claire, du savon, le tout s’écoulant dans le trou des toilettes. Toute neuve, nous repartons vers la capitale et je promets à cette belle femme de parler d’elle. La fin de la journée arrive rapidement et nous devons reprendre la route avant que la nuit ne tombe. Nous arriverons sur la capitale bien tard et je dirais à M. que ce n’est pas un au-revoir.
Sao-Tomé et la route du centre
Les jours suivants, l’atmosphère change. Les gens commencent à me dévisager dans la rue. Jusque-là pacifiques et souriants, certains hommes m’agressent verbalement en me surnommant « coronavirus » et en me demandant où est mon masque. Un vol de rapatriement a été mis en place et tous les français non résidents sont priés d’aller s’inscrire auprès de la TAP. Je passe mes journées à stresser à chaque message du groupe whatssap que la consule vient de créer. J’ai peu de temps pour échanger avec le français et les enfants qui viennent tous les jours à la maison. Mon rhume imaginaire finit par reprendre le dessus. M. s’offre comme cette boule d’air frais quotidienne, qu’on n’avait pas demandé et qui, pourtant, devient si vitale. Il me dit de relativiser, de profiter de l’instant présent, mais comment profiter de chaque moment lorsqu’on n’a pas de date fatidique ? Vous savez celle qui permet de programmer les prochains jours, de savoir si l’on rentre ou pas ?
M. me propose de partir pour la journée découvrir le centre de l’île, vers Monte Café où son père vit. La route est courte comparée au sud. J’insiste pour faire la randonnée qui nous mènera au Lagoa Amélia, pour découvrir une infime partie du Parc naturel Ôbo (qui recouvre quand même 30% de l’île de Sao Tomé !). M. n’aime pas marcher et me certifie qu’il n’y a pas grand chose à voir. Pourtant il m’y emmènera.
Ce jour-là, les nuages s’épaississent et ne présagent rien de bon. Pourtant je suis ravie d’avoir le nez dehors, loin de la pression de la petite capitale (et de ces histoires de rapatriement). Nous marchons et la pluie commence à tomber. L’ eau traverse chaque parcelle de nos vêtements tandis que la culpabilité imprègne mes pores. « Pauvre M. j’ai insisté pour faire cette randonnée et maintenant il va être tout trempé ». Nous continuons coûte que coûte et je souris doucement en repensant au Parc national de Taï, où nous avions été surpris par la pluie et où l’eau était montée très rapidement jusqu’aux genoux. La sensation est la même dans cette ancienne colonie portugaise. Je ne vois plus où je mets les pieds. Nous finissons par arriver… puis nous reprenons le chemin en sens-inverse, trempés jusqu’à la moelle mais encore chauds de notre marche. Nous nous abritons devant le micro-supermarché du coin. Les habitants s’y sont donnés rendez-vous pour laisser passer la pluie. Les hommes que nous avions croisés qui partaient aux champs de bon matin, sont eux aussi à l’abri, attendant tranquillement que les trombes passent. Avec M. nous sommes frigorifiés. Je lui prête ma serviette et vais me changer dans l’arrière boutique. Je ne sais pas pourquoi ce jour là, je me suis dit qu’il serait utile de prendre des vêtements de rechange. Malheureusement j’ai oublié qu’il faisait frais dans les hauteurs du centre.
J’achète quelques bananes séchées pour nous faire patienter et espérer que la digestion nous réchauffe. La pluie finit par s’arrêter. Nous remontons frigorifiés sur la moto en direction du Jardin Botanique, quand nous croisons le guide qui s’occupe des visites: « j’ai fini pour aujourd’hui, il n’y a aucun touristes ». Nous bifurquons jusqu’à la Cascade de Sao Nicolau, avant de rejoindre Monte Café. C’est ici que se trouve la plus ancienne plantation de café de l’île. Il est en temps normal possible de visiter la plantation et le petit musée adjacent. Sauf qu’à un jour près, le gouvernement a annoncé la fermeture des principaux lieux touristiques. Nous ne le savions pas. La Casa Almada Negreiros, où nous devions prendre notre repas, est elle aussi close pour la journée. Nous profitons néanmoins d’une tasse de café bien chaude avant de repartir sur la capitale.
A l’aéroport de Sao-Tomé
M. me ramène à la TAP car c’est le jour où je dois acheter mon billet d’avion à 1400 €. De quoi rester des mois à Sao-Tomé… Je rentre dans l’agence et en ressort en pleurs 5 min après. Je n’ai pas envie de partir. Pourquoi le devrais-je ? Les jours se mélangent, les idées aussi. Je ne sais plus quoi faire. M. me rassure et me dit que je serais peut-être mieux auprès de ma famille. Il m’avouera plus tard qu’il aurait aimé que je reste. Je rentre à nouveau dans la boutique le cœur serré. La responsable m’annonce qu’elle n’a pas de billet pour moi. Le soulagement m’envahit. Et pourtant le lendemain, la consule décidera de m’amener à l’aéroport pour me faire monter dans ce foutu avion.
Je fais mes valises en quelques minutes, explique au français ce qui se passe. Je n’ai pas le temps de dire au-revoir aux enfants que j’ai croisé dans la maison, ni de remercier chaleureusement mon précieux guide. Je monte dans la voiture et arrive en très peu de temps à l’aéroport. En route la consule m’a trouvé un billet, il faut que je reparte sur la capitale. Son chauffeur m’embarque. Je paye et retourne à l’aéroport, complètement démunie par cette décision de dernière minute que je n’ai finalement pas prise. Tout s’enchaîne. Le français parle avec des clients. M. me fait la surprise de me rejoindre à l’aéroport, tandis que je suis entrain de batailler pour avoir un billet me ramenant du Portugal jusqu’ en France. Il ne peut contenir ses larmes… Le cœur fendu, c’est à moi de le rassurer cette fois. Et pourtant je suis déjà loin au cœur du néant. Je ne suis plus moi-même. Je viens de passer en mode automatique, celui que me permet de partir toute en légèreté, sans penser à quoi que ce soit et surtout pas à l’amertume qui va m’envahir ces prochains mois.
Des mois plus tard
Je suis en colère. La colère qui fait monter les larmes aux yeux. Pourquoi suis-je partie ? Pourquoi ai-je quitté ce petit paradis pour me réfugier dans le pays qui m’a vu naître, celui qui ne m’a jamais contrôlé aux frontières alors que j’avais de la fièvre, celui qui m’a pris pour une vache à lait et qui m’a fait angoisser pendant des mois et qui aujourd’hui joue encore avec mes nerfs ?
J’ai continué à parler portugais, tous les jours avec ce guide qui était venu me voir, pleurant de toutes ses larmes à l’aéroport. Tous les jours. Mon niveau augmentait. Tous les jours je me disais que je devrais aller tester mon portugais, là où tout avait commencé ou fini: à Sao-Tomé. Je crois que je n’ai jamais réussi à me pardonner. Me pardonner d’avoir quitté ce pays, d’avoir laissé la Consule m’embarquait dans sa voiture pour me faire monter dans l’avion, de ne pas avoir tapé du point sur la table pour dire que « non j’avais raison », que « non la COVID ne toucherait pas autant le continent africain ». Mais l’influence m’a transformé en mouton. ça fait des mois que ça tourne en boucle dans ma tête. Des mois à essayer de me donner raison, de me rassurer, de me dire que j’avais fait le bon choix alors que tout mon être me disait que non. Je me suis perdue dans le yoga, je n’arrivais plus à lire, encore moins à écrire. Seul le portugais me donnait encore cette joie de vivre, celle qui me permettait de rêver à un meilleur avenir.
Alors Sao-Tomé fut pour moi une petite île difficile, celle de la fièvre, de la maladie*, celle des choix à prendre dans une période indécise, celle de l’espoir aussi… celui d’y retourner à tout moment, à chaque annonce de reconfinement. Celui de la reconnexion totale avec des racines oubliées, ces plantes qui peuvent encore soigner. Ces rêves enfouis mais peu oubliés qui permettent de tenir sur un continent stressé par ses objectifs économiques. Je me prends encore parfois à rêver de ce petit paradis, où le mot d’ordre « leve, leve » (doucement, doucement) semble prendre tout son sens.
Un jour alors je reviendrais. Je prendrais quelques jours dans le sud pour décompresser, pour regarder les vagues et me laisser embuer l’esprit de douceurs fragiles. Je prendrais des litres d’eau et ma tente, pour aller arpenter le Pico le plus haut du pays et peut-être observer Principe, haut lieu de biosphère splendide qui me fait rêver. J’y verrais peut-être ces fameux pirates dans les eaux tumultueuses du Golfe de Guinée. Je me perdrais à nouveau dans les couleurs des marchés, goûterais enfin à ce gâteau à l’avocat, irait revoir Maria rencontré un soir dans la rue des joueurs d’échecs. J’irais donner un coup de main à ce français, qui a bien voulu m’héberger dans une période difficile. Je reverrais M. et me laisserais porter par ses idées, ses envies de faire connaître son pays, ce petit coin de paradis. Et enfin, je passerais faire un coucou à ceux qui sont venus me chercher à l’aéroport le 1er soir, alors que le climat mondial semblait hésitant.
* On ne saura jamais ce qu’était ce rhume intense et passager,
et je me serais assurée des semaines après mon retour de n’avoir contaminé personne.
Musique: Calema
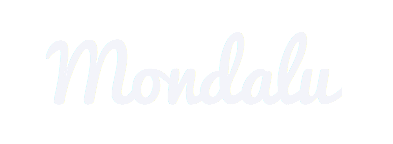































Il est beau cet article. Très beau !
Merci beaucoup Cédric, cela me touche !
Oui, très beau récit! :- )
Merci beaucoup Maxime ! Bienvenue par ici 🙂