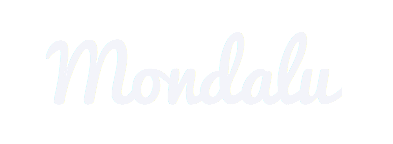Updated on décembre 15, 2024
Korhogo, perle ivoirienne du nord
Korhogo c’est l’histoire d’un week-end, d’une future coloc qui me parle déjà de mon nouveau pays d’accueil, d’un ex venu du nord assez secret sur ses coutumes. Il comparait Korhogo à Tamale, ville ghanéenne découverte lors de notre précédent voyage au Ghana, sans pour autant s’émanciper sur le sujet. Korhogo, c’est une ville entre traditions et modernité, comme un rite de passage qui nous ouvre les portes du sacré.
Départ pour Korhogo
Situé à 563 km d’Abidjan en passant par Yamoussoukro, Korhogo se ralie en 8h en voiture ou 10h en bus. Je choisis la compagnie de bus GTKA nouvellement ouverte et récupère mon billet la veille en gare d’Adjamé. Plusieurs compagnies se rendent au nord… vous n’aurez que l’embarras du choix.
Veille du week-end de Pâques, le bus est complet et je suis bien sûr la seule blanche dans le convoi. Chacun rejoint sa famille pour le week-end prolongé et retourne au village.
Le temps passe vite avec un petit somme par-ci, un arrêt pipi par-là et les séries africaines façon télénovella. Je suis toujours impressionnée par la dextérité des femmes qui descendent pour uriner, enroulant un pagne autour de la taille… je n’ai jamais testé ayant bien trop peur de le mouiller (à savoir que le bus s’arrête souvent au milieu de nulle part). Très peu d’échange avec mon compagnon de route cette fois, qui m’offre tout de même un bonbon pour la gorge. Je plonge doucement dans mes souvenirs d’Inde, où cette vieille femme toute ridée m’avait offert le plus beau des sourires.
Je finis par arriver à destination, légèrement perdue… ici ce ne sont pas des taxis voitures, mais des taxis moto comme au Bénin et je ne connais pas le nom du quartier que je cherche à rejoindre. Heureusement, nous sommes en Afrique… les gens sont toujours ravis de vous aider. Je demande ma route à l’assistant du chauffeur, qui m’assoit à côté de deux personnes âgées habillées de leurs boubous majestueux, et qui me propose de l’attendre dans la gare du bus le temps de sa prière. Il finit par me rejoindre et me dit qu’il m’amène à destination: au Centre d’Hébergement de Korhogo, se situant à la cathédrale. Ce dernier propose des chambres toutes simples, avec lit, ventilateur, douche et wc pour 5000 FCFA la nuit (soit 7€). Des chambres climatisées sont également à disposition.
Arrivée au centre, je demande où je peux aller manger et un gars rentrant chez lui à vélo décide de m’accompagner sur la route… jusqu’à ce que j’entende mon prénom: « Lucie, c’est Mamadou ».
Mamadou
Mamadou est le guide que j’ai contacté quelques jours plus tôt, qui m’a été conseillé par une amie. Nous avions échangé via whatsapp et je n’avais rien conclu avec lui car je préfère rencontrer les gens en face, afin de mieux les cerner. Rien qu’avec ma photo sur whatsapp (et surement ma couleur de peau) Mamadou m’aborde comme une vieille amie qu’il vient de croiser dans la rue. « C’est incroyable, je venais justement en ville pour acheter du crédit et t’appeler ! » me dit-il. Les étoiles sont alignées, pensais-je.

Mamadou est un Sénoufo, ethnie ivoirienne que l’on rencontre au nord du pays. Il vient du village de Waraniéné, dont un de mes invités sur mon éductour quelques jours auparavant m’avait parlé.
Mamadou a le sourire facile. Je sens qu’on va bien s’entendre…
Il m’invite à m’assoir pour un plat de riz, poisson sauce (pour 500 fcfa) dans un buibui du coin et on commence à échanger sur le but de mon voyage. Je lui sors la liste de mon vidéaste ivoirien préféré et il me garantit qu’en 3 jours, je peux tout faire sauf la belle mosquée en bambou qui est bien trop loin. Je négocie doucement le prix et on scelle notre accord avec un large sourire et une bonne poignée de main. Il me raccompagne sur son scooter du nord et je me dis que ces trois prochains jours vont être à la hauteur de mes espérances.
Pour le contacter: +22507116110
Sur la route des artisans
Le lendemain, il me récupère à l’heure prévue me prêtant un casque et nous nous mettons en route. Au programme du jour: Kapélé, Waraniéné et le Mont Korhogo.
Kapélé et ses perles colorées



Nous commençons par Kapélé où nous trouvons les artisans qui créent encore les perles à la main. On m’explique qu’après avoir récupéré l’argile au bord de la rivière, on forme des boules que l’on enroule autour d’une tige (celle utilisée pour filer le coton), pour former le trou. Une fois la base créée et sèche, ils mettent les perles au four (dans un trou recouvert de branchages) pour les figer. C’est alors que l’artiste peut commencer à les peindre. Ici les couleurs naturelles sont les seules utilisées: le blanc vient du kaolin, le jaune de la terre, le vert des feuilles de kinkalba et le rouge du teck.
Pour créer des formes aussi nettes, le peintre coince la tige en bambou entre ses orteils pour la faire tourner, tandis que le bout d’une plume lui sert de pinceau.
J’ai du passer une heure à observer les œuvres de ces hommes du nord. Ce travail est réservé à ces derniers et les perles étaient autrefois utilisées lors de cérémonies. Aujourd’hui c’est toujours le cas, mais une partie est laissée aux touristes et vendue sur les marchés. J’ai failli tout acheter, mais je me suis dit que vous aussi vous aimeriez porter un de leurs colliers. Je me suis donc contentée de quelques boucles d’oreilles pour les copines, un collier nature (non verni à la sève des arbres) et quelques perles magnifiques en vrac. Mamadou me presse légèrement, me disant en souriant qu’il y a encore plein de choses qui m’attendent.
Les tisserands de Waraniéné



Nous filons dans son village pour découvrir les tisserands de Waraniéné. J’avais déjà eu le plaisir d’observer le travail de ceux de Man, mais avec les explications de Mamadou la découverte est complète. Il m’explique alors que les femmes filent le coton que l’on trouve dans la région et que les hommes sont en charge de la confection des bandes, qui serviront ensuite à la confection de boubou ou de nappes. Les plus jeunes attachent les bouts de coton entre eux pour former de longues lignes, qui sont ensuite installées sur les métiers à tisser. Ils s’entrainent ensuite sur des motifs faciles tandis que les plus expérimentés tissent des motifs plus détaillés. Ils passent leur journée à tisser et il faut savoir qu’une pièce peut prendre 3 jours.
On me propose de tester et je m’attèle avec attention à la tâche. Mes pieds sont trop courts pour les pédales (chaque métier à tisser est réglé à la taille de son artiste), qui permettent d’intervertir les bouts de coton alignés en haut et en bas. Heureusement le jeune artisan m’aide et je fais passer la pelote à droite et à gauche, tout en tassant mon tissage avec le morceau de bois suspendu.
Les pagnes traditionnels sénoufo sont magnifiques et la tentation est encore grande… je me laisse le week-end pour réfléchir. Mamadou m’accompagne dans sa famille pour le délicieux repas du midi.
Le rocher sacré de Chien Léo

Le rocher sacré de Chien Léo se situe à 10 min de Korhogo. Ces lieux sacrés africains me font bizarrement penser aux lieux sacrés aborigènes. On y retrouve toujours cet ensemble de gros cailloux qui tiennent debout comme par enchantement.
Ici un homme est assis sous l’un des gros rochers. Mamadou m’explique que c’est le gardien, celui qui effectue les sacrifices pour chaque passant. La personne va amener un poulet au gardien, qui va le sacrifier et mettre du sang et des plumes sur la pierre pour remercier les esprits de leurs bonnes grâces. Le poulet va ensuite être mangé sur place.
Un peu plus loin derrière, ce sont des femmes qu’on rencontre, attendant sagement avec leurs grigris la personne qui voudra faire appel à leurs dons. Je rencontre l’une d’elle, pour un échange émouvant.
Carrière de granit


Changement d’atmosphère avec la découverte de la carrière de granit. Mamadou m’explique que ce dernier est encore récolté à la main dans cette carrière. Des bouts de bois chauffés sont glissés à travers les fentes pour dégager les plus gros morceaux. Femmes et hommes travaillent ensemble et les enfants sont souvent sur place (au lieu d’aller à l’école) car le repas est cuisiné au cœur même de la carrière par chaque famille. Nader, le blogueur rencontré sur un voyage de presse, m’expliquait que les travailleurs gagnaient environ 1000 FCFA par jour (soit 2€). Vendredi, jour de ma visite, très peu de monde était présent à la carrière, car la plupart des familles vont à l’église. Trois messieurs nous accueillent près de leur abris et nous proposent le meilleur des thés (ah que je l’aime ce thé… vert de Chine, chauffé à l’ancienne avec un brin de gingembre et beaucoup de sucre). Mamadou me raconte qu’une carrière avec des machines s’est installée dans le coin il y a quelques années, limitant le prix d’achat du granit. Heureusement les hommes lui confirment qu’ils arrivent aujourd’hui à maintenir leurs conditions de vie grâce à certains fidèles qui viennent encore leur acheter le granit taillé à la main.
Je sors pantoise de cette visite et me dit qu’heureusement je n’ai vu personne travailler sous ce soleil de plomb.
Ascension du Mont Korhogo
Après une journée bien remplie, nous filons au marché de Korhogo où Mamadou tient à me montrer la partie réservée aux guérisseurs. On y trouve de tout: des crânes de singe, des peaux de serpent, des bracelets en argent réservés aux grigris, etc.

Puis nous montons jusqu’au sommet du Mont Korhogo surplombant la ville du nord. Les nuages omniprésents ne laisseront pas le soleil nous illuminer de sa superbe, mais j’en profite pour papoter avec mon guide sur les traditions ivoiriennes.
Sur la route des Baobabs
Le lendemain, nous prenons la route de Fakaha pour aller admirer les Baobabs. Le premier a plus de 200 ans et le fruit du Baobab aurait de nombreux bienfaits sur l’organisme. La partie jaune est notamment utilisée dans une des sauces locales, et j’ai vu qu’une femme à Abidjan en faisait des bonbons.



Puis nous reprenons la route vers Fakaha pour la découverte des fameuses toiles de Korhogo.
Fakaha et ses peintures sur toile
On a l’habitude de les appeler « toiles de Korhogo » et pourtant c’est bien dans le village de Fakaha que les artistes se mettent à l’œuvre. Les peintures sont ici aussi à base de couleurs naturelles, posées sur des tissus en coton local, tissés à Waraniéné. Soro Navaga, l’artiste dessine les contours au couteau puis m’explique qu’il doit d’abord poser une base de peinture marron, afin que la couleur noire puisse accrocher au tissu.


Il me raconte aussi que Picasso est venu jusqu’à Fakaha pour apprendre de ces artistes du nord et que c’est lui, qui aurait recommandé à la communauté, de faire des contours sur leurs toiles pour faire ressortir leur œuvre comme dans un cadre. Soro me sort alors la vieille toile peinte par Picasso, qu’il garde précieusement loin de la poussière orangé, qui aura fini par revêtir mes jambes d’un joli bronzage artificiel lors de nos trajets en moto. Ce travail est à nouveau réservé aux hommes, et j’observe les plus jeunes s’entrainer sur de petites toiles (dont les touristes sont friands).


Je finis par acheter une belle toile de Fakaha, pensant qu’elle me rappellera mon échange avec ce vieil artiste sénoufo. Je lui fais tout de même remarquer qu’il n’y a, à ma connaissance, pas de girafe en Côte d’Ivoire. Les toiles représentent, en effet, souvent des animaux ou des rites initiatiques sénoufo.
Le plus grand antiquaire de Korhogo

Il est temps de retourner sur Korhogo et d’aller rencontrer le plus grand antiquaire de la ville, Mr Souleymane Arachi. Il m’ouvre la porte d’un petit hangar dans le quartier Haoussabougou et j’y découvre des masques entassés à l’abri de la lumière. Il m’invite à y rentrer, tandis que Mamadou s’installe confortablement sur la chaise en bois posées devant.
Je suis un peu apeurée par le nombre de masques, et je dis en rigolant que ces derniers me font peur. Il me fait sortir de l’hangar et m’ouvre une autre porte… il y en a tout autant. Ce n’est pas 2 pièces qu’il finit par me faire visiter mais au moins 10 ! Je suis stupéfiée par le nombre d’antiquités qu’il collectionne. Il me raconte alors que c’est une histoire de famille, et que son père en est le précurseur. Pour sa part, il s’en va chercher de belles pièces délaissées dans les villages de la région, où les chefs du village lui racontent souvent que tel ou tel masque a servi à telle cérémonie ou telle occasion. Et c’est là que je le vois…
Un vieux masque Sénoufo, anciennement utilisé pour une cérémonie, caché sous d’autres masques. C’est sa couleur patinée par le temps qui m’attire… mais le manque de place dans mon sac du week-end et dans mon sac pour un retour en France imminent, font que je le laisserais parmi l’un de ces hangars.
Les sculpteurs de Koko
Certains masques ne sortent que pour certaines cérémonies ou certains initiés. C’est-à-dire que les non-initiés n’ont pas le droit de voir certains masques.
Mamadou m’entraîne dans le quartier des sculpteurs non loin de la Grande-Mosquée, où chacun a son petit réduit avec une micro-galerie. Ayant passé beaucoup de temps chez Mr Souleymane, il est vrai que je n’ai plus beaucoup d’énergie à consacrer à ces artistes de tout âge. Je prends tout de même le temps de visiter chaque galerie et le dernier jeune homme me remercie, tout fier de pouvoir me montrer son travail. Ce sont tous de grands passionnés et je suis admirative de ce qu’ils peuvent faire de leurs mains. Travailler le bois, quel métier ♥
J’en apprends donc un peu plus sur la signification de ces masques… On me montre des masques aussi petits que ma main, que l’on appelle « masque passeport ». Tel un passeport ou une carte d’identité, ils indiquaient à l’époque de quelle région le propriétaire venait, que ce soit en Côte d’Ivoire, au Mali ou au Burkina Faso. Le calao, grand oiseau que l’on retrouve un peu partout dans le pays, est un animal protecteur. Plusieurs significations lui sont associées et on le retrouve souvent sur les masques sénoufo.
Funérailles
Le soir Mamadou me convie à des funérailles. Un peu mal à l’aise à l’idée, pensant que ce n’était pas ma place, je me retrouve finalement parmi la foule joyeuse, riant, chantant et dansant au son du balafon et autres instruments.
Le balafon est cet instrument construit avec une base en bois, reliée par de la peau de chèvre, sur lequel on ajoute de belles pièces encore en bois à l’image d’un xylophone. La différence ici est que sous chaque morceau se trouve une calebasse de taille différente, permettant au son une résonance impressionnante et une mélodie variée.
C’est à ce son que j’observe avec timidité la famille dansant dynamiquement et l’ensemble de la communauté réuni pour célébrer l’être vivant qui vient de décéder.

Cases à fétiche et karité
Dernier jour de visite et nous partons à 60km de Korhogo, à Niofoin. Sur la route, nous ne manquons pas de croiser les policiers, toujours avides de récupérer le n° de téléphone d’une femme blanche (pour se marier soit-disant) et quelques dozos, personnages hautement respectés en Côte d’Ivoire pour leurs secrets de chasse et gardien de certains pouvoirs mystiques.
Village de Niofoin
Nous finissons pas arriver à Niofoin où Mamadou m’explique qu’ici vivent des animistes et que dans la tradition, l’homme a droit de se marier avec plusieurs femmes. Ainsi l’homme a sa propre case et les femmes autour ont la leur qu’elles partagent avec leurs enfants. De petits constructions servent de grenier, où la récole y est rangée. Ces dernières sont légèrement surélevées pour protéger la récolte des inondations. Les graines sont récupérées par le haut, en enlevant le toit, tout au long de l’année.
La case à fétiche est la seule construction, où le toit est renforcé chaque année, d’où son chapeau impressionnant (qui sert d’ailleurs de refuge à certains oiseaux).
C’est ici que les habitants du village viennent prier, faire des sacrifices et remercier les esprits à travers des offrandes. La case a une allure impressionnante et mystique.


Comme dans tous les villages que nous avons traversés, je laisse quelques savons aux personnes qui m’accueillent, sur les conseils de Mamadou. Il est assez mal vu de venir sans rien, mais cela crée une attente envers les touristes. Ainsi les enfants qui me couraient après dans l’espoir d’avoir des bonbons m’ont fait culpabiliser, pensant bien faire de ne pas vouloir leur en donner. Le guide leur expliquait alors que ce n’était pas bon pour les dents (excuse que je lui ai sorti lorsqu’il me parlait d’en acheter pour les enfants). Je ne sais toujours pas quelle position tenir à ce sujet… Et vous ?
Beurre de karité
Nous rentrons ensuite sur Korhogo, dans le quartier du Petit Paris, à la rencontre de la coopérative de beurre de karité. Ici seules les femmes travaillent, et la vente du karité leur rapporte un petit revenu tout au long de l’année. C’est un travail de longue haleine. Il faut d’abord récolter les graines (juin-septembre), enlever la première couche verte et la pulpe, laisser les noix obtenues sécher au soleil. Ces dernières peuvent alors être conservées pour le reste de l’année. On concasse ensuite les noix pour obtenir les amandes. Lavées, séchées au soleil, elles sont ensuite passées au moulin pour obtenir de petits morceaux. Ces derniers sont mélangés avec de l’eau et c’est l’étape du barratage. Les femmes brassent la pâte obtenue avec de longues spatules, tandis que le mélange chauffe. L’huile remonte à la surface, tandis que les impuretés restent en bas. Ces dernières sont récupérées pour former des boules, qui serviront de bio-charbon pour faire chauffer les futures marmites. Le beurre est ensuite récupéré et stocké.
Ici le kilo équivaut à 1000 fcfa (soit 2€) ! Le beurre a une couleur légèrement jaune et une odeur plus marquée que ce que l’on trouve en commerce, mais avec un max de principes actifs. Celui que l’on achète blanc et sans odeur a été raffiné, mais on perd de suite en qualité. Il est donc possible de rajouter quelques huiles essentielles pour équilibrer l’odeur. Et au moins ici, on sait que l’argent bénéficie directement aux productrices (parce que 10€ le beurre de karité bio… c’est choquant, vu le prix initial !).




Il est déjà temps de partir, Mamadou a une dernière surprise pour moi.
Danse Boloye
N’ayant pas les moyens de m’offrir une danse traditionnelle à moi toute seule (compter 40000 Fcfa, soit 60€), Mamadou m’intègre à un groupe. Tout au long de mon séjour, mon guide m’explique un peu ce qu’est le « Poro », qui est l’un des rituels initiatiques (le plus courant) par lequel doit passer chaque jeune sénoufo. Il est le fondement de la vie sociale, religieuse et politique. Ce que j’appelle « initié » tout au long de l’article, est quelqu’un qui a reçu ou est entrain de recevoir cet enseignement. C’est principalement au cœur de la forêt sacrée, attenante à chaque village que le sénoufo le reçoit.
Il faut savoir que chaque village de la région est divisé en deux: la partie musulmane avec sa mosquée et la partie animiste avec sa forêt sacré. Il y a dans chaque village deux chefs: l’un musulman et l’autre animiste, qui se rencontrent lors des grandes décisions attenantes au village.
C’est à Waraniéné, le village des tisserands, que nous retournons pour admirer la danse boloye. Cette dernière fait partie des rites initiés et c’est l’une des rares danses qui peut être montrée aux yeux des touristes. La danse boloye est aussi connue sous le nom de danse panthère, faisant référence à l’accoutrement des danseurs (à savoir que les panthères existent en Côte d’Ivoire).


Vous l’aurez compris Korhogo et la région des Savanes regorgent de surprises. Que vous aimiez l’art, l’artisanat, la culture, les traditions, les rencontres, les mythes, l’agriculture (avec ses champs de coton et d’anacharde), les initiatives durables, etc. le nord de la Côte d’Ivoire en est riche. Ce petit week-end prolongé m’a beaucoup touché, sans que je puisse expliquer pourquoi. De voir que les locaux ont réussi à garder leurs coutumes malgré la colonisation et qu’aujourd’hui ses dernières attirent quelques touristes curieux, me laisse un doux goût de satire.

Updated on décembre 29, 2024
Bénin et salsa
Un festival de salsa se présentait au Bénin. Mon prof, originaire du pays, y allait avec sa partenaire de danse. Ni une, ni deux, je décidais d’embarquer dans une mini aventure d’une semaine avec eux.
Départ d’Abidjan
J’aurais adoré prendre le bus, pour traverser le Ghana et le Togo, avant d’arriver à destination.
Surtout que le bus coûte moins cher et est plus écologique que l’avion. Comptez 30 000 FCFA l’aller (contre 150 000 FCFA en avion). Seulement voilà, à deux semaines du départ, il me fallait faire une demande pour 3 visas, n’étant pas sure de pouvoir obtenir les visas de transit à la frontière. Ayant déjà fait l’expérience de la frontière Ghanéenne, je n’avais pas envie de parlementer avec les contrôleurs… ni de faire 4 allers-retours dans les embouteillages et la pollution abidjanaise (oui je vous vends du rêve) pour aller aux ambassades respectives de chaque pays. Heureusement le visa pour le Bénin se fait directement en ligne et l’obtention est immédiate.
Arrivée au Bénin
Récupérée par le frère de mon ami, je me suis laissée guider les premiers jours. Je retrouvais Julie pour mon début de festival… les cours et soirées ont suivi en belle compagnie.
Le dernier jour, nous avons passé un après-midi sur la plage, avec un groupe d’artistes Guadeloupéens, à parler de rencontres, de musique et de joie de vivre. Ce petit moment convivial m’a rappelé pourquoi j’adorais le voyage. Ces rencontres fortuites qui te donnent une joie immense et ces personnes que tu connais depuis 2 min, et que pourtant tu arrives à comprendre instantanément.
Ils ont souhaité venir jusqu’au Bénin pour s’y marier… sur la terre de leurs ancêtres. Ils voulaient aussi faire comprendre au peuple africain le lien qui pouvait exister entre leurs cultures à travers la danse. Comprenez que l’esclavage a laissé des traces… mais qu’aujourd’hui il est temps de rapprocher deux mondes si éloignés et pourtant liés par leurs histoires passées. Pour ces deux acolytes, le lien peut se faire à travers la musique, la danse et le partage de leurs traditions respectives. Julie, l’ivoirienne, était étonnée de voir que dans les danses traditionnelles guadeloupéennes on retrouvait les mêmes pas que ceux utilisés par son ethnie Bété. Et moi en fond, ravie et émue de voir tout ce beau monde échanger, grandir et s’enrichir ensemble au fil d’une conversation… le voyage rapproche et panse le monde, j’en suis convaincue !
Porto-Novo
Mes amis étaient déjà appelés à rentrer sur Abidjan. Mais avant de partir, le prof nous a emmené sur la terre de ses ancêtres, à Porto-Novo.
Accueillie par un brin de salsa, je me sentais déjà bien dans les rues de la capitale Béninoise (et oui, Cotonou n’en ai que la capitale économique !). Le lien Afro-Caraïbes se faisait à nouveau ressentir, tel un boomerang historique.
Nous déambulions dans les rues du Grand Marché, à l’affût des couleurs et douceurs béninoises. Je goûtais au chat-noir (fruit du tamarinier noir), au fromage Peulh (fromage frais, encore meilleur revenu deux minutes à la poêle) et finissais mon repas par quelques arachides.
Nous avons fait un stop au centre Songhai, lieu d’entrepreneuriat agricole durable, avant de ne partir à la rencontre de la femme la plus marquante de mon séjour: la grand-mère de notre hôte.


Je ne mettrais point les photos ici, par respect pour cette dame de plus de 100 ans. Elle ne parle pas le français, alors notre ami traduit pour nous: « Je ne peux plus me servir de mes jambes, mais j’y vois clair ». Comprendre qu’elle a toute sa tête.
Et ça se voit, avec son petit sourire en coin de femme espiègle, elle nous accueille à bras ouvert dans sa petite chambre. La complicité entre elle et son petit-fils est si forte, que je suis submergée par l’émotion. Et j’en viens à me demander ce qu’on a fait pour se couper nous Européens, entre générations.
Après cette séquence émotion, nous optons pour une pause culturelle au musée Honmé ou musée du Palais Royal. La visite coûte 5000 FCFA et le guide nous plonge au cœur de l’histoire des rois de Porto-Novo, qui avaient élu domicile à cet endroit.


La visite de la capitale touche à sa fin et nous retournons sur Cotonou, afin de partager une dernière béninoise, la bière locale au goût de miel, avant que les deux amis ne retournent sur Abidjan.
Ouidah
On me dépose au départ des voitures partagées allant à Ouidah, où je reprends mon voyage en main. 1h (et 1000 fcfa) plus tard j’arrive à Ouidah, où une moto taxi me dépose à Le Jardin Secret Chez Pascal, petit coin de paradis à quelques pas du centre ville.
Après avoir déposé mes affaires, je file à la Fondation Zinsou, pour le déjeuner. J’y déguste l’Amiwô, pâte rouge béninoise, accompagnée d’une sauce arachide avec du fromage Peulh. Un délice ! Puis je profite de l’exposition du moment pendant la digestion.



Je file ensuite à l’Office de Tourisme de la ville pour trouver un guide officiel. C’est Hervé qui m’accompagne sur la route des Esclaves. Mon précédent voyage au Ghana m’avait permis de prendre conscience de cette période sombre de l’histoire, mais l’arrivée à la « porte de non-retour » me laisse toujours autant de marbre. Devant la beauté de l’océan, il est parfois dur d’imaginer ce que vivaient ces gens déportés, enchaînés et qui partaient pour ne jamais revenir.




Je continue ma visite de Ouidah avec Hervé, qui m’emmène chercher sa fille à l’école, avant de ne me montrer l’espace qui lui permettra d’héberger des touristes. Ancien de Nomade Aventure, l’envie de prendre son envol a été plus forte. Au retour il me montre quelques bâtiments coloniaux, témoignage du faste de l’époque, quelque peu oublié, puis me mène au temple des Pythons, où je débute mon apprentissage du Vaudou.
Grand-Popo
Le lendemain, j’intercepte une voiture, qui me mènera jusqu’à Grand-Popo, à quelques minutes de la frontière togolaise. Je demande à un taxi moto de me conduire au Victor’s Place, endroit conseillé par un français rencontré la veille à Ouidah. Je me retrouve dans un lieu plein de charme en face de l’océan. En attendant Herman le gérant mais aussi guide touristique, je me détends sur l’un des hamacs géants, en admirant les pêcheurs remonter sur la plage leurs filets de pêche, synchronisant leurs mouvements de hanche avec des chants entrainants.


Herman finit par arriver et s’installe sur le hamac pour parler tourisme et avenir. Deux autres touristes nous rejoignent et nous partons pour un mini-tour des environs avec notre guide. Nous prenons une barque qui nous mène au village sacré de Hévé, où le culte Vaudou est fort présent. De fétiches en fétiches, Herman nous explique que le vaudou a une connotation négative dans les pays occidentaux, alors que cela semble relever d’un simple culte animiste, où les forces de la nature et le respect des ancêtres sont très présents. Le Vaudou est réservé aux initiés, mais ces derniers ont le droit d’être chrétien ou musulman. Ainsi, on parle plus de traditions ou de mode de vie, que d’une religion à part entière.
Je trouve ça passionnant. Après avoir vécu quelques mois en Côte d’Ivoire, où les locaux croient aux esprits maléfiques et à la sorcellerie, j’écoute Herman avec beaucoup de respect et de curiosité. Les poupées vaudous n’existeraient donc pas au Bénin et sembleraient confondus avec les fétiches qui ont tendance à faire peur aux non-initiés. Saviez-vous que le mot « charlatan » avait une connotation positive en Afrique ? Peut-être qu’au temps de la colonisation, les européens en voulant imposer la religion catholique, ont cherché à diaboliser des traditions ancestrales et pourtant bien ancrées.


Après cette séquence culturelle, nous retournons sur notre embarcation pour naviguer sur le fleuve Mono, jusqu’aux mangroves où Herman nous explique qu’elles sont actuellement protégées par une association.


Le soir, nous profitons du délicieux rhum arrangé de la maison, avant que je ne me retrouve coincée dehors, mon bungalow fermé avec la clé à l’intérieur. Je passerais la nuit allongée sur un banc, pensant au vaudou et aux mythes qui l’entourent.
Possotomé
Le lendemain, je voulais pousser jusqu’à Abomey et ses palais royaux, mais je décidais de suivre les deux acolytes toulousaines dans leur escapade du jour, profitant d’une nouvelle nuit à Grand-Popo. Nous partions pour la journée à Possotomé.


Découverte de l’artisanat, balade en pirogue, distillerie de sodabi (koutoukou béninois), déambulation au marché du troc et dans la forêt sacrée… étaient au programme.





Puis nous retournions à Grand-Popo pour une dernière soirée, avant que je ne regagne Cotonou.
Ganvié
A Cotonou, David l’ami de mon prof de danse m’emmène à Ganvié. Nous prenons un bus pour rejoindre l’embarcadère, avant de ne prendre une pirogue pour quelques heures de navigation.


Le capitaine de notre pirogue à voile, a cherché à nous faire payer tout le long de notre parcours… c’était assez désagréable. Nous n’avons pas eu droit aux explications le long de notre aventure aquatique, ayant laissé les commandes à mon hôte du jour. Renseignez-vous bien avant de vous laisser embarquer.
Nous avons quand même profité des paysages alentours, admirant la vie locale de ce village béninois sur l’eau. Magnifique !



Le soir, les gars m’ont fait tester les différents mets béninois, dont j’ai encore oublié les noms, après maintes répétitions. Un délice…
Comme quoi chaque pays de l’Afrique de l’Ouest a ses propres spécialités, et il serait dommage de se limiter à l’un d’eux.
J’aurais adoré aller jusqu’à Abomey en apprendre plus sur les rois, crapahuter au cœur des collines de Dassa-Zoumé, découvrir le pays Somba et surtout admirer les animaux sauvages au Parc de la Pendjari. Un guide sénégalais, basé au Bénin, rencontré au Ghana (j’adore le voyage !) m’avait tant vanté les merveilles de ce parc… beaucoup moins connu que ceux en Afrique du Sud et au Kenya, mais recelant pourtant de beautés animales. J’aurais aimé aller jusqu’au nord du pays, observer les lions dans un cadre beaucoup plus sauvage et moins « parc animalier », mais le temps m’était conté.
Alors cher pays, ce fût un plaisir que de découvrir ton sud… Tes habitants sont si patients, bienveillants, chaleureux et attachants ! Sache que je reviendrai.

Updated on octobre 9, 2019
Force et confiance : Afrique
L’ Afrique: un non-choix
L’Afrique n’a jamais été un choix. Outre les montagnes de l’Atlas ou les étendus de sable Mauritanien, le continent africain ne me faisait point rêver.
Et pourtant j’y ai posé les pieds, il y a quelques mois, une opportunité professionnelle m’amenant en Côte d’Ivoire.
Je pense que j’y suis partie avec beaucoup de préjugés. J’aime parler avec les autres expatriés, pour comprendre leur rapport au pays, leur vécu plein d’apprentissage perpétuel. Une collègue m’a dit hier soir, qu’il fallait 3 ans au moins pour bien vivre son expatriation. La première année, on découvre. La deuxième année on cherche son équilibre et la 3ème on le trouve.
J’ai toujours cru que j’avais une capacité d’adaptation supérieure à la moyenne, après toutes ces années de mouvement. Vous vous imaginez déménager tous les 6 mois pendant 10 ans ? Aujourd’hui, lorsque je raconte ça, on me demande simplement : pourquoi ?
Et cette question, je me la suis posée maintes fois. Par fierté, par faiblesse, par facilité, par habitude, par opportunités ? J’ai toujours répondu que c’était à cause de mes CDD à répétition, ou peut-être parce que je me lasse vite des lieux, des choses que je fais… mais jamais des gens.
Aujourd’hui, cela fait 8 mois que je suis en Côte d’Ivoire, et cela faisait si longtemps que ça ne m’était pas arrivé. Le coup de cœur n’est pas là certes, car loin des montagnes et dans une ville où je ne peux marcher, je me sens prisonnière d’un monde qui ne me ressemble pas. Et pourtant, j’apprends tellement.
Amour et haine
J’ai une sorte de relation d’amour et de haine. J’ai été en colère longtemps, car fatiguée, je me sentais seule alors que j’étais entourée, mais loin de ceux avec qui j’avais cette connexion à laquelle j’attache énormément d’importance. Alors certes j’arrive à jongler avec différentes personnalités, et cela m’enrichit au quotidien. Mais à 30 ans, on a vite fait de savoir avec qui tu as envie de papoter et ceux qui ne te sont d’aucune utilité ou qui ne te mettront pas à l’aise.
Aujourd’hui encore je me dis que ça ne sert à rien d’aller vers les nouvelles rencontres, car si il le faut, je partirais dans 4 mois… et alors les au-revoirs sauront d’autant plus difficiles.
Petite je vivais tellement dans le passé. Aujourd’hui je vis trop dans l’avenir.
Les questions me submergent de temps en temps et je les repousse brutalement, sans parvenir à les chasser de mon esprit, ou sans en trouver les réponses clés qui me permettraient de me poser.
Se poser. « Tu as envie de quoi ? » Me poser, répondais-je.
Fraichement débarquée d’Australie, je me foutais la pression pour me poser dans ma nouvelle maison : Lyon. Mais je ne m’étais pas rendu compte que le verbe même avait une connotation négative pour moi. Se poser signifiait encore il y a quelques mois « se figer, se structurer, s’arrêter »… et cela ne me ressemble pas. Je suis encore l’enfant curieux que j’étais il y a 20 ans. Je ne peux m’arrêter d’apprendre et de vivre, et si ça doit passer par le mouvement constant, alors tant pis. En voulant « me poser » absolument, je décidais de rentrer dans le moule que les autres attendaient de moi. Du moins c’est ce que je croyais. Mais qu’est-ce que les autres attendent vraiment de toi ? Qu’est-ce que moi, personnellement, j’attendrais des autres ? Et bien si vraiment, tu attaches de l’importance à ce que les autres pensent de toi… dis toi que l’inverse peut être vrai, et que si toi tu attends des autres simplement qu’ils soient heureux (et c’est le cas), alors attend la même chose de toi.
Étapes importantes
J’ai fait un constat aujourd’hui. Ma vie a été peuplée de différentes étapes clés.
Il y a eu ma période clubbing, où je prenais un brin confiance en moi sur les podiums des boîtes de nuit. Il y a eu ma période Canada, où je découvrais les joies et malheurs de vivre dans un autre pays. J’associais alors le voyage avec les mots apprentissage perpétuel et curiosité émancipée. Puis il y a eu le retour en France, où je me suis sentie déséquilibrée et où j’ai fini par me laisser bercer par une ouverture à l’autre. Il y a eu mon année parisienne, un brin joueuse et déstabilisante. Puis mon ras-le-bol et mes trois ans et demi de route en Océanie, où j’aurais appris que la liberté était finalement intérieure… et qu’en rejetant tout ce qu’il y avait autour de moi, ça n’avancerait pas. Mes remises en question, la décision de faire confiance à l’autre… sans pour autant me faire confiance à moi. Et aujourd’hui la Côte d’Ivoire.
Je pensais honnêtement que ça serait un voyage « extérieur ». Une année où je ne serais que spectatrice d’un mode de vie différent. Une année riche professionnellement parlant mais pauvre personnellement. N’ayant pas choisi de venir au pays, je pensais qu’il ne m’apporterait rien… et pourtant.
Je finis toujours par me dire que les choses arrivent pour une bonne raison.
Mon choix a été difficile. J’ai beaucoup pleuré. Je ne m’y voyais pas. Je ne voulais quitter mes montagnes. Je ne voulais déposer mes chaussures de randonnée. Je ne voulais transpirer sous la chaleur ivoirienne, je ne voulais pas de tout ça. Mais j’ai fini par faire mes valises et franchir le pas, n’ayant d’autres opportunités professionnelles plus viables.
Danse
La Côte d’Ivoire, un jour je l’aime, un jour je la déteste.
Je pense que toute relation au pays, à l’environnement qui nous entoure, reflète assez ce que l’on pense de soi-même. Un jour je m’aime, un jour je me déteste.
Ce constat je l’ai fait que bien récemment.
Lorsque je suis en colère contre quelqu’un, je me pose un instant et me demande pourquoi. Et souvent je me retrouve à répondre « parce que je suis en colère contre moi-même pour telle et telle raison ». Peut-être que vous trouverez cela tiré par les cheveux, mais essayez un instant… et revenez me dire ce que vous en pensez. J’aurais le plaisir d’apprendre de vous et de vos expériences.
La vie est riche où que l’on soit. Et c’est à travers les rencontres que l’on en apprend le plus sur soi. Ces années en dehors de chez moi m’auront tant apportée, tant déstabilisée… mais c’est pour que j’aille chercher au plus profond de moi.
Ne pouvant m’atteler à la randonnée, qui me donnait cette liberté d’être moi-même dans les montagnes, je me suis tournée vers la danse. Par curiosité au premier abord, par souhait d’apprendre, puis de perfectionner … mais je ne pensais pas que cette activité pouvait m’apprendre autant que le voyage.
A travers un simple cours aujourd’hui, j’ai réalisé plein de choses et me suis questionnée sur des sujets qui ne me seraient même pas venus à l’esprit.
« Pourquoi as-tu toujours voulu renier ton côté artiste, celui qui te faisait pourtant vibrer petite ? » « Pourquoi as-tu toujours cherché à cacher ta féminité ou à te cacher tout court ? » « Pourquoi cherches-tu désespérément à ce que les autres te voient, sans pour autant être avenante, souriante, vibrante ? » Petite, je boudais toujours sur les photos ou restais toujours dans mon coin, dans l’espoir au plus profond de moi, que quelqu’un vienne me prendre par la main et me dise qu’il ou elle me voyait et que j’étais importante.
J’ai encore ces réflexes… et pourtant je sais aujourd’hui que je suis la seule amenée à me prendre par la main pour me dire que tout ira bien.
Et bien je vous souhaite à tous et toutes, pour 2019 et toutes les autres années à venir, de vous chercher, de vous trouver et surtout de vous aimer.
Updated on décembre 29, 2024
Course poursuite au Ghana
Un petit moment que je n’avais pas pris de vacances et l’envie de montrer à un ami ivoirien ce que je pouvais bien trouver d’aussi épanouissant dans mes voyages, nous a fait prendre la route en cette fin d’année 2018. Un pays anglophone et limitrophe pour éviter de prendre l’avion et c’est au Ghana que nous partions.
Ne pouvant abandonner son confort, mon compagnon de route décidait de prendre sa voiture pour les deux semaines de vacances que je m’étais octroyée. Mais les deux semaines se sont vite transformées en une. N’ayant pas le permis international, nous nous sommes « arrangés » mais le temps passé aux barrières de police me semblait à chaque fois une éternité. En résumé, ce voyage n’a pas été de tout repos.
Départ pour Accra
Nous partions pour Accra un 30 décembre, au lieu du 26 itinialement prévu par mes soins dans le but de participer à la première édition du festival Afrochella. La frustration était déjà lancée avant même le départ, mais je me suis fait une raison voulant profiter à fond de cette nouvelle découverte.
La route au départ d’Abidjan a été longue… non pas à cause de l’état du bitume (plutôt normal à ma grande surprise) mais plus en rapport aux nombreux barrages sur la route.
Nous arrivons à Accra de nuit et galérons à trouver notre petite auberge de jeunesse, sans batterie sur nos téléphones. Nous chargeons nos téléphones grâce à la générosité des gens et me retrouve dans une petite boutique de coiffure de nuit, entourée de femmes ghanéennes adorables et de leurs enfants.
Nous finissons par trouver tant bien que mal notre auberge du soir, quand Mr décide de se laisser conduire par mes dons de liseuse de carte. Heureusement que notre adresse du soir est au top, et que la pression retombe de mes épaules pour 2 nuits consécutives.



Au coeur de la capitale
Le lendemain matin, le délicieux petit-déjeuner (avec les délicieux pancakes au goût de gingembre) nous requinque et c’est parti pour une journée culturelle. Mais rien ne se passe comme prévu !
Nous avions prévu de découvrir le jardin botanique, un peu excentré de la ville, et j’en profite pour nous faire passer par le centre commercial, le Marina Mall, pour faire du change et acheter une carte sim (ce que nous aurions du faire dès la frontière). Arrivés au Marina Mall, on nous dit de partir à Accra Mall pour trouver nos chères cartes, mais mon gps nous perd sur les échangeurs et nous nous retrouvons sur l’autoroute qui quitte Accra vers l’Est. Au péage, nous rencontrons Precious, un ange tombé du ciel, qui s’arrange avec la police pour nous permettre de faire demi-tour et nous accompagne dans nos périples de carte et changements de plans importuns. Quelques heures plus tard, nous avions enfin accès à Internet, abandonné l’idée d’aller jusqu’au jardin, une voiture réparée de son bruit bizarre mais un compagnon voulant trouver des pièces… pour sa caisse !
Je décidais alors d’abandonner mes deux comparses pour une escapade au musée national du Ghana: vide !
Je prenais alors un taxi, jouissant de ma nouvelle liberté et discutant de mon nouveau pays d’accueil avec le chauffeur pour me diriger vers Osu Castle: fermé ! Décidemment, Accra me jouait des tours, dès mon premier jour. Je décidais alors de marcher, afin de rejoindre Jamestown, l’un des plus vieux quartiers d’Accra.

Quel bonheur de pouvoir enfin marcher dans une ville ! C’est une chose qui me manque terriblement à Abidjan. Ici sur mon parcours, je profite du trottoir longeant la route, pour apercevoir l’Arche de l’Indépendance et attérir au Centre pour la Culture nationale, qui est en fait un ensemble de magazins et boutiques pour ramener des souvenirs touristiques. Je me laisse entrainer par « Million » qui fabrique ses propres Djembé et me propose un cours improvisé au coeur de sa boutique. Je me dis alors que je suis bien au Ghana.


Mais ce petit plaisir est de courte durée, Precious me rappelle afin que je retrouve mon compagnon de voyage, avant de nous quitter pour aller donner sa messe du 31 au soir.
Ce dernier a envie de rentrer, mais je le traine jusqu’au JamesTown café, afin de manger un bout et humer un brin d’atmosphère de ce quartier de pêcheur, si vibrant lorsqu’on y traverse les minis ruelles en voiture. La pause fait du bien après cette journée, quelque peu décevante mais dont je prendrais le meilleur (une des choses que j’apprends en Afrique). Le café est presque vide, mais on y découvre un lieu plutôt alternatif, où les concerts de musique live doivent faire vibrer l’espace les jours animés. A quelques pas de là, nous découvrons un coin où le street art se mélange aux cris joyaux des enfants du quartier. Nous rentrons finalement à l’auberge épuisés et sans motivation pour célébrer cette nouvelle année.


Le 1er, nous profitons de la visite de Osu Castle, heureusement ouvert en ce premier jour de l’année. L’endroit est magnifique, mais l’explication du guide sur son passé colonial et son histoire lié à l’esclavage, rend le lieu triste.
Nous décidons ensuite de quitter Accra pour des contrés plus ensablés à quelques heures de là.


Ada Foah
Nous prenons la route pour Ada Foah, à 1h30 d’ici. Arrivés à destination, nous empruntons une pirogue (40 cedis A/R) pour rejoindre Maranatha Beach Camp où nous allons passer la nuit. 40 cedis pour un bungalow les pieds dans le sable et la possibilité d’observer les tortues de nuit (rajouter 40 cedis), lorsque les membres de l’équipe se motivent…
J’en profite pour chiller sur les hamacs, goûter au vin de palme local, avant de repartir le lendemain vers la frontière togolaise.




Frontière togolaise
Le lendemain c’est vers Wli que nous nous dirigeons. Nous posons nos valises au Waterfall Lodge, petit lodge tenu par des allemands (compter 100 cedis pour un bungalow à 2). Un endroit pour manger et lire est prévu à cet effet, avec une magnifique vue sur les alentours.
Nous profitons de l’après-midi pour aller aux cascades de Wli. Nous optons pour les 4h de balade nous permettant d’aller admirer la cascade la plus haute. Une randonnée de 6h est possible permettant d’accéder à la plus haute chaîne de montagne ghanéenne. Pour les balades, il suffit de se rendre à l’office des guides dans la ville et de s’aquitter du droit de passage de 40 cedis (+ pourboire à prévoir pour le guide qui vous accompagne).
Les lumières du soir rendent l’endroit sublime mais je vous conseille de partir de bon matin, pour bien prendre le temps d’apprécier votre randonnée et la baignade dans l’eau glacée, avant que le soleil ne se couche.



Le lendemain matin, je décide de m’offrir une randonnée en haut du plus haut mont du Ghana, le Mont Afadjato à 885 m (20 cedis l’entrée). Officiellement c’est le plus haut mont « solitaire », mais officieusement si vous avez lu mon paragraphe précédant les chaînes de montagnes attenantes à la cascade sont plus hautes.
Nous continuons ensuite vers le nord, dans l’espoir d’atteindre Tamale dans la soirée, alors que je serai bien restée une nuit de plus au lodge nous accueillant.
Au nord du Ghana
Google maps n’étant pas toujours ton ami, surtout dans les pays d’Afrique, la route nous a pris plus de temps que prévu. Les locaux nous indiquant que la route que l’on souhaitait prendre était mauvaise, nous avons alors jonglé avec les indications du gps et celle des ghanéens un peu perdu par notre itinéraire.
Nous sommes passés par des routes non bitumées (me rappelant l’Oodnadatta Track en Australie), et la pression que j’avais par rapport à la voiture de mon compagnon de route (finie à temps pour le voyage) ne faisait que monter. Arrivés de nuit à Bimbila, le policier au barrage nous explique qu’il y a un couvre feu et qu’il est impossible d’avancer (sauf si l’on décide de payer et d’être escortés par les militaires). Nous décidons de dormir dans la voiture en attendant les lueurs du jour.


Parc national de Mole
Finalement arrivée à Tamale au petit matin, nous continuons directement jusqu’au Parc national de Mole. Complètement fatiguée, je décide de contacter un couchsurfeur à Larambaga, qui avait donné son ok pour nous héberger deux jours après. Hyper réactif, il accepte et nous nous retrouvons au coeur d’un orphelinat géré par notre hôte. Un des orphelins, Rachid, m’accueille avec un grand sourire et ne manque pas de m’exiber autour du stade de foot du village, pendant que mon compagnon de voyage roupille dans la chambre qui nous a été octroyée. Le soir nous partageons un repas ensemble, et je retrouve la joie du couchsurfing et des rencontres improvisées. Une petite pause pendant cette course poursuite au Ghana…
Le lendemain notre hôte, qui travaille de temps en temps pour le Parc national, nous accompagne au coeur de celui-ci. Compter 40 cedis par personne pour les droits d’entrée hors ghanéens. Nous avons de la chance ce matin là, un autre groupe de français souhaite faire un safari véhiculé et nous partageons les frais s’élevant à 100 cedis par jeep. Finalement le safari à pied est tout aussi intéressant et coûte 10 cedis.
Nous avons la chance d’y observer un éléphant, mes premiers phacochères et des antilopes de plusieurs espèces.




La plateforme d’observation du môtel et du lodge, au coeur même du parc, offre des vues différentes et permettent l’observation des animaux. La meilleure période pour observer les éléphants serait fin février, début avril, moment où ils se déplacent en groupe.
Kumasi
Nous arrivons le soir même à Kumasi. Tellement épuisée par la route, je n’ai pas eu le temps la vieille de chercher où on allait dormir le soir… voulant profiter au moins de l’une de mes soirées en contact avec la population locale. Je dirige donc mon pilote vers le 1er hôtel conseillé par une amie, mais la route se trouve coupée et les embouteillages me laisse pantoise. Nous optons donc pour le 1er hébergement pas cher sur la route et quelques brochettes dans le quartier, avant de m’écrouler sur le lit dont j’appréhende les puces.
Le lendemain, nous filons au Palais du Roi Ashanti, pour comprendre l’histoire de ce peuple également présent en Côte d’Ivoire. On y apprend que la succession se fait selon les choix de la mère, et que ces derniers sont restés fiers pendant la colonisation anglaise. Une visite passionnante.

Je n’aurais ensuite pas le courage d’aller au marché de Kumasi, qui occupe une grande partie de la ville, à la recherche de pagnes ashanti. Nous repartons donc vers le sud, ne nous arrêtons pas sur la route au Parc national de Kakum (la copilote s’étant endormie).
Cape Coast
Arrivés à Cape Coast, je profite de la visite guidée de l’après-midi pour visiter le fort au même nom. Je me retrouve avec un groupe d’américains, en pélerinage sur les traces de leurs ancêtres. La visite est émouvante, le fort impressionant et les visites des lieux où les esclaves étaient enfermés étouffantes sous la chaleur de ce mois de janvier. Ici derrière la « porte de non retour », la porte qui menait les esclaves aux bateaux voguant vers d’autres contrées, une inscription plus récente invite les descendants à revenir comprendre leur histoire et retrouver leurs racines, malgré les horreurs de ces années d’esclavagisme. Je vous invite d’ailleurs à lire cet article: http://www.slate.fr/story/172113/ghana-commemoration-esclavage-afro-descendants




Retour ivoirien
Pour ma part, je profiterais d’un dernier repas ghanéen, au Baobab House, auberge de jeunesse proposant également des repas végétariens. Un « red red » pour la route, mélange d’haricot rouges et bananes plantains, et nous repartons vers Abidjan avant la date butoire de notre laisser passer ghanéen, nous arrêtant tout de même au beau matin à Elmina.



Le retour a été long… mon cerveau embrouillé par les kilomètres avalés ou le palu qui me guettait. Je suis arrivée à Abidjan avec une fièvre élevée et l’envie d’oublier ces vacances presque gachées.
Le Ghana a été pour moi une succession d’images, dont je n’ai pas pu en apprécier les couleurs. Je n’arrive plus à voyager avec « une liste de choses à faire », j’ai besoin de prendre mon temps. C’est un peu comme si je voyais le soleil sans ressentir la chaleur des rayons sur ma peau… Et là clairement, j’ai été pressé tout le long par mon compagnon de voyage. Un voyage à deux, ça se contruit à deux et c’est parfois difficile lorsque ces compagnons de route n’ont pas les mêmes valeurs, les mêmes attentes. Et j’en avais surement beaucoup pendant ce trip.
Mais heureusement la plus belle a été atteinte: Avoir pu apporter un peu plus de simplicité dans la vie de mon compagnon de route. Alors c’est tout ce que je retiendrais de ce voyage, un brin contre la montre, en dehors du pays magnifique qu’est le Ghana et le charme plutôt posé de ses habitants.