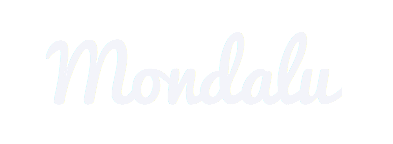Posted on juin 8, 2021
La tête dans le ciel, les pieds sur terre: portrait de Laureen
Je connais Laureen depuis un stage dans la même société en 2010, lorsqu’à l’époque nous nous occupions de promouvoir de belles destinations touristiques sur le marché français. La vie parisienne battait son plein, les missions nous passionnaient et l’équipe de stagiaires étaient alors bien soudée. Chacun prit sa route, mais quel ne fut mon plaisir de voir que cette ancienne collègue s’était lancée dans un projet passionnant, qui semblait si bien lui correspondre ! Ni une, ni deux, j’ai voulu reprendre contact, en savoir plus, afin de mettre en lumière un beau début d’aventure.
Un parcours dans l’évènementiel
Depuis notre rencontre, Laureen me raconte avoir travaillé dans l’hôtellerie à Paris, puis avoir migré à Bruxelles pendant 3 ans pour rejoindre le secteur évènementiel. Elle travaillait alors pour la Commission européenne. Sans parler néerlandais, difficile d’évoluer en Belgique, elle décide donc de rentrer en France pour rejoindre GL events à Nantes.
Trois années passent. Afin d’élargir ses compétences en stratégie, elle entame une année de formation continue en communication chez Audencia. Elle est ensuite recrutée chez Airbus pendant un an en intérim. Au 1er confinement, elle saisit l’opportunité d’être libre pour murir un projet entrepreneurial, qui lui trotte dans la tête depuis quelques années.
Et si c’était le moment de se lancer ?
L’alliance de plusieurs passions
En 2017, Laureen découvre une marque de sacs fabriqués à partir de voiles de bateau recyclées, lancée par des passionnés de navigation. « J’adorais leurs valeurs et leurs messages » me dit-elle. « Pourquoi ne pas s’en inspirer pour allier ma passion pour la montgolfière et la couture ? ». Pourquoi pas en effet !
Couturière amatrice, Laureen se met à confectionner des masques pendant le confinement et l’idée lui revient. « Et si la couture était à la base de mon projet ? ». En octobre 2020, après avoir collecté une première montgolfière réformée, elle commence ses prototypes et réalise que finalement « la couture j’aime ça mais juste pour les cadeaux de noël » me confie-t-elle en rigolant.
En novembre – décembre, elle bénéficie d’ un accompagnement collectif proposé par la BGE Atlantique Vendée, où elle rencontre d’autres entrepreneurs aux projets très différents. « Cette démarche m’a aidée à structurer mon offre, à formuler mes valeurs, à trouver mes partenaires fabricants et à définir mon positionnement. Grâce aux études de marché et à mon intuition, j’ai su établir un business plan ». Laureen bénéficie du regard extérieur et ses quelques mois de jeune entrepreneuse la confortent dans son projet. « J’avais une idée en tête… je vais la mener à bien et voir où elle me mène ». Notre créatrice du jour trouve cette expérience enrichissante: « je rencontre plein de gens différents et j’apprends en continu ».
Découverte du monde de l’upcycling
« Même si le contexte est incertain suite à la crise sanitaire, cela m’occupe et me stimule ». Laureen se rend vite compte que son projet s’inscrit dans une sphère existante où des gens passionnés partagent et créent à partir de matériaux déjà utilisés. « J’ai participé à un webinaire de 2 jours avec de grandes enseignes, des créateurs indépendants et organisations de protection de l’environnement, tous impliqués dans la revalorisation de matières existantes. Ces échanges m’ont donné envie de persévérer dans mon projet ».
Dès janvier 2021, Laureen souhaite aller au bout de ses démarches. « L’ entrepreneuriat est l’opportunité de m’investir dans des processus de décisions quotidien et de mener des missions de A à Z ». Polyvalente et Autodidacte, elle se lance dans la création de son site Internet, monte une vidéo de présentation et mène sur tous les fronts sa campagne de communication.
Depuis le 10 mai 2021, il est d’ailleurs possible d’encourager sa jeune marque sur la célèbre plateforme de financement participatif.
Naissance de Mes Dames Mes Cieux ©
Pilote de montgolfière depuis 2008 et présidente de l’association « Ciel de Loire » en région nantaise, Laureen a la tête dans le ciel mais bien les pieds sur terre. En alliant sa passion à l’un de ses loisirs (initiée à la couture par sa grand-mère Henriette dès son plus jeune âge), Laureen nous propose aujourd’hui des articles de bagagerie, de décoration de mode et de papeterie, fabriqués à partir de toiles de montgolfières recyclées. Ces créations uniques et fabriquées en France s’inscrivent aussi dans une démarche d’ insertion.
En effet, si Laureen découpe les toiles en optimisant les tissus préalablement collectés, elle confie la confection des objets finis à un chantier d’insertion. Aux origines géographiques et aux parcours de vie riches en histoires, les citoyens du monde de la structure nantaise, subliment sacs et corbeilles. Tandis que les nœuds papillon sont cousus par une couturière indépendante, une créatrice textile brode les cartes et marque-pages. La gamme est complète et élégante à l’image de la fondatrice. Laureen ne manque pas de goût et d’anecdotes à raconter !
Sa gamme papeterie est d’ailleurs née de l’histoire commune du papier Canson et des montgolfières, tous deux inventés en Ardèche par la famille Montgolfier, respectivement en 1557 et en 1783. Un partenariat avec Canson permet d’ailleurs à Laureen de revaloriser du papier déclassé. La boucle est bouclée !
L’ upcycling a encore de beaux jours devant lui et je crois sincèrement à la nouvelle aventure entrepreneuriale de Mes Dames Mes Cieux ©. Pas vous ?
Et si on l’amenait plus loin, à l’image d’un vent frais et serein ?

Updated on décembre 29, 2024
Tour du Pic du Midi d’Ossau, 4 jours de trek dans les Pyrénées
Nous devions partir dans le Néouvieille, à l’assaut des lacs dont on me parle tant depuis quelques années. Je les attends depuis un moment car nous devions nous rencontrer lors de ma traversée des Pyrénées qui s’est vu écourtée deux ans en arrière. Au vu de la météo, je propose à mon compagnon de route de nous rapprocher du Pic du Midi d’Ossau, découvert en septembre dernier en rentrant d’Espagne. Nous repérons quelques cabanes, regardons la météo pour la centième fois et tentons l’aventure sur le week-end de l’Ascension.
Du lac de Bious-Artigues au refuge d’Ayous
△ 5.7 km / 570 m D+ , 9 m D-
Après quelques heures de route au départ de Toulouse, nous arrivons sur le parking du lac Bious-Artigues qui est déjà rempli de voitures. Pourtant le temps n’est pas au beau fixe. Le ciel est parsemé de nuages éparses et nous espérons passer entre les gouttes en ce début de trek. L’ assombrissement est encore au loin et nous tentons de passer par le Col d’Aas de Bielle afin de rejoindre le Col d’Ayous pour une après-midi teintée de challenge. Nous n’étions pas hyper confiants à l’idée de la neige prévue à partir de 1800 m… c’est pourquoi lorsque nous croisons des randonneuses nous leur demandons ce qui s’en vient. « Nous avons fait demi-tour au col, la neige est là et les traces sont absentes ». Nous décidons de rebrousser chemin jusqu’au lac et de rejoindre le GR10, par la cabane du Col Long d’Ayous.
C’était finalement une bonne idée, car les gouttes commencent déjà à tomber, légères sans qu’elles ne viennent refroidir mon envie de randonner. Nous continuons vers la cabane Roumassot, où les premiers lacs d’Ayous apparaissent bien calmes face à la météo qui change. Du lac Roumassot, nous longeons au loin celui du Miey et le lac Gentau, avant de bifurquer à gauche sur le PR, laissant le GR10 s’éloigner vers la droite. La pluie se fait de plus en plus intense, le ciel s’est assombri et pourtant nous apercevons encore le Pic du Midi d’Ossau derrière les nuages.
Le refuge d’Ayous n’est plus très loin. Après avoir admiré la petite cabane qui s’est faite privée à quelques mètres de la cascade, nous rejoignons le bruit de l’eau pour remonter à sa source et suivre le sentier jusqu’au refuge. Le vent s’est levé et nous apercevons un gars essayant tant bien que mal de monter son abri pour la nuit, tout sourire avec vue sur le Pic du Midi, caché derrière de gros nuages. Le paysage est devenu irréel. L’impression de me trouver au cœur d’une Islande sauvage en plein hiver me vient à l’esprit et je souris à la chance que j’ai, d’avoir eu une collège généreuse quant à mon jour de congés.
Nous finissons par arriver au refuge, sous un froid prenant. La partie hiver est belle et bien ouverte et personne à l’horizon. Tout est propre et je choisis le matelas qui accueillera mon sac de couchage gonflant. Je suis contente de le retrouver après quelques mois de repos. Ce début de trek annonce une nouvelle saison d’aventures, où la marche berce ce besoin de reconnexion au temps.
La nuit prend entièrement place, tandis que la neige saupoudre l’entrée de notre demeure du soir. Personne ne viendra s’aventurer dans cet antre au milieu des montagnes et nous passerons la soirée à discuter, jusqu’à ce qu’il se fasse tard et que les souris viennent hanter ma nuit.
Du refuge d’Ayous au refuge de Pombie
△ 13.74 km / 807 m D+ , 751 m D-
Le lendemain, la neige a pris place et nous restons au chaud espérant une éclaircie. Mon compagnon de route sort pour humer l’air et croise des randonneurs qui attendent midi pour partir sur le même chemin que nous. « Le temps doit changer » nous affirment-ils. Après un petit-déjeuner et une sortie de duvet difficile, nous voilà dehors sous la neige à avancer sur le PR longeant le lac Bersau.
La vue est bouchée. Heureusement que les traces du groupe parti plus tôt le matin sont encore visibles. Il est 11h et le temps ne s’est toujours pas éclairci. Nous avançons doucement sous la neige, et je me sens comme une enfant écoutant les bruits étouffés alentours et mes pieds faisant craquer le doux manteau neigeux encore fragile déposé cette nuit. Je suis optimiste… les conditions météorologiques ne m’atteignent pas, je profite juste de la joie d’être au dehors loin d’un écran d’ordinateur, à profiter du paysage brouillardeux que nous offre la nature. Je me sens légère, et même si ma nuit fut courte, mon sac semble flotter au dessus de mon dos.
L’arrivée au Lac Bersau gelé est splendide. Les nuances de blanc prennent la pause le temps d’une photo, tandis que le soleil semble vouloir prendre place à travers le ciel grisonnant. Les traces de pas se font imprécises. Le groupe semble d’être perdu au niveau du lac, bifurquant vers la gauche au lieu de longer ses bords duveteux. Nous sortons la carte pour vérifier et retrouver des traces un peu plus loin nous menant vers ce qui semble être le printemps. Ce deuxième jour de trek s’apparente à une année: nous nous réveillons en hiver pour découvrir quelques heures après le printemps, puis l’été.
Lorsque nous laissons le PR qui continue vers l’Espagne et que nous empruntons le GR 108 vers le Lac Casterau, tout change. Nous croisons des randonneurs nous expliquant que la neige n’est plus. Il suffira de descendre sur un chemin boueux et parfois glissant pour nous retrouver au lac et observer les nuages dansant. Le soleil joue avec eux, transformant la neige en une pluie fine.
Nous continuons notre descente et la vallée se dégage doucement. La vue s’ouvre sur une palette de vert intense. Le blanc a laissé place au printemps et nous profitons du soleil pour nous poser dans l’herbe afin de pique-niquer. Un peu plus tard, toujours émerveillés par ce revirement de situation, nous atteignons la Cabane du Cap de la Hosse pour nous arrêter un instant. « Dormons-nous ici ce soir ? Ou continuons-nous ? » Il n’est que 15h mais le prochain endroit sec pour dormir se nomme le refuge de Pombie.
Nous décidons de poursuivre afin de profiter du beau temps qui ne pourra guère tenir au vue des prévisions météos du week-end. Il faut déjà repartir pour atteindre le refuge avant la nuit. Au détour de la cabane de Cap de Pount, nous croisons le groupe de jeunes qui nous ont offert leurs traces matinales. Ils ont l’air perdu. Ils ont fait quelques détours non voulus avec une carte peu détaillée et finissent par nous suivre de près dans la montée. 500 m de dénivelé positif nous attendent jusqu’au lac de Peyreget. Avec une matinée neigeuse dans les pattes, mon sac léger du matin se transforme en fardeau imposant.
Heureusement nous finissons par arriver au lac, où je m’octroie une pause afin de recharger les batteries et prendre quelques photos. Le spot est génial pour un bivouac. Ce trek de cabanes en cabanes, me donnent envie de revenir avec ma tente mais je sais les lieux un peu trop fréquentés en plein été.
Les jeunes ont fini par nous rattraper et passent devant nous. Nous les suivons.
Je me délecte des vues de l’Ossau, jusque-là caché sous le brouillard ou derrière un nuage. Cet après-midi il se déguise en extraverti, nous laissant entrevoir une montée difficile jusqu’au sommet. Heureusement nous n’avons pas prévu de l’arpenter et nous nous laissons charmer par ses douceurs sauvages.
Au bout d’un moment, je finis par trouver le temps long. « Es-tu sûr que nous avons pris le bon chemin ? Les jeunes de devant se sont maintes fois perdus ». « Oui nous devrions arriver au refuge d’en pas très longtemps ». Un refuge se présente à nous au loin, avec une route bitumée. « C’est bizarre ». Nous continuons tant bien que mal et mon compagnon finit par sortir sa carte. « Regarde, le Col de l’Iou, nous l’avons passé ! lui dis-je. Il me semblait bien que l’Ossau avait changé de profil ». Nous pensions passer par le col de Peyreget, mais en suivant les jeunes et sans voir d’autres sentiers, nous arrivons par surprise au Col de Soum de Pombie. Le tour du Pic de Peyreget finit tout de même par nous guider vers le refuge du soir et nous aprendrons plus tard que le Col de Peyreget était finalement impraticable.
Du refuge de Pombie à la cabane de Magnabaigt
△ 4.7 km / 100 m D+ , 439 m D-
Nous passons la nuit au refuge de Pombie entourés de jeunes ronfleurs. Heureusement le sommeil finit par m’emporter après une journée 4 saisons, qui m’offrit l’observation de marmottes pyrénéennes et de belles prises de vue, clôturée par un petit apéro en bonne compagnie. La montagne rend les gens abordables et sympathiques, et ça qu’est-ce que ça fait du bien !
Le lendemain, la journée s’annonce courte. Nous pourrions retourner au parking du lac de Bious-Artigues, mais nous avons encore une journée devant nous. Nous nous dirigeons vers le Col du Suzon. La neige fait à nouveau son apparition via quelques plaques éparses. Les traces du Sahara quelques mois après que le sable fut entrainé par les vents, sont encore là. La lumière est belle et les montagnes réapparaissent mystérieuses après s’être dévoilée lors d’une après-midi ensoleillée.
Nous finissons par arriver jusqu’à la cabane de Magnabaigt, à côté d’un torrent gelé. L’ occasion de se rafraichir après 2 jours de marches de s’octroyer un cocon de confort au travers d’une pluie fine qui rejoint le périple. Un aller-retour dans la forêt mitoyenne pour du bois et c’est le poêle qui finit par réchauffer nos cœurs bercés par la magie des lieux. Des livres, des bouteilles, des bougies… la vie semble vive lorsque le berger rejoint sa cabane l’été. Je me rêve avec quelques bêtes au milieu des montagnes, puis je me souviens que la vie peut être rude en solitaire sous les orages. Le feu crépite et demande beaucoup d’attention, tandis qu’il me ramène en Tasmanie au milieu de l’Overland Track. Quelques heures à tenir. Un brin d’histoires. Une douce musique de Sao-Tomé et c’est l’heure d’opter pour un couscous royal.
De la cabane de Magnabaigt au lac de Bious-Artigues
△ 2.7 km / 52 m D+ , 278 m D-
Notre trek de 4 jours prend fin. Le Tour du Midi d’Ossau peut se faire en une seule journée. Mais cela serait gâcher la déconnexion totale que nous amène ce pic majestueux des Pyrénées Béarnaises. Prendre son temps. Rêvasser à travers un temps changeant. Apercevoir le sommet derrière un nuage. Le retrouver lors d’une éclaircie. Se surprendre à rigoler du temps qui passe. L’impression d’être partie un mois au bout du monde, alors que non, on est seulement à quelques heures de Toulouse.
L’ arrivée au Lac de Bious-Artigues se sera faite en compagnie des bouquetins. Les chaussures à peine changées que la pluie revient. Le retour se fera sous une symphonie chaotique et mon ventre se serrera de tristesse à l’idée de m’éloigner à nouveau des montagnes et de cette échappée belle vécue le temps d’un week-end.

Updated on avril 16, 2021
Rencontre littéraire: Les Éditions Prunelle
J’ai découvert Blandine Carsalade, en venant m’installer dans le Tarn. C’est une publication sur les réseaux sociaux, qui m’a interpellé et puis au fil de mon boulot, j’ai eu l’occasion de l’interviewer. Son projet me parlait tellement que j’avais envie de partager avec vous son portrait, comme une ode vers un monde innovant certes, mais surtout apaisant.
Du monde de la finance au monde du livre
Blandine me raconte qu’elle a fait un master en finance de marché et qu’elle a travaillé pour de grandes banques. C’est en devenant maman, qu’elle découvre la littérature jeunesse. Elle me confie n’avoir pas trouvé de livres qui parlaient des sujets, qu’elle souhaitait aborder avec ses enfants.
Un jour, en lisant Blanche Neige à sa fille, celle-ci lui dit: « maman si j’avais un miroir, je lui poserais plein de questions ». D’une affirmation innocente, s’ouvrit un monde du possible, celui d’écrire des histoires qui dé-formatent et qui donnent du sens.
Du livre de Blanche Neige, Blandine réécrit l’histoire: celle de deux femmes qui se battent, non plus pour la beauté, mais pour le pouvoir. Et pourquoi pas au final ? Pourquoi ne pas donner aux jeunes filles l’envie de s’élever dans leur carrière professionnelle ou dans leur vie ? Pourquoi ne pas donner aux garçons ou aux jeunes enfants sans étiquettes, la liberté de se voir les uns et les autres, comme ils souhaiteraient l’être ?
Des livres aux sujets d’actualité
Les livres de Blandine sont toujours inspirés de ses enfants. Un jour, elle marchait dans la rue avec sa fille, quand celle-ci lui tira le bras et lui dit: « maman, tu as vu le monsieur qui tendait la main ? ». Et bien non, le SDF était devenu invisible à ses yeux, sans qu’elle ne s’en aperçoive. Les adultes ne les voient plus… les enfants eux, se trouvent encore à leur hauteur et ne peuvent détourner le regard. Cet évènement a inspiré à Blandine, la série « Mr L’Ombre », retraçant l’histoire d’un sans domicile fixe.
De sujets en sujets, les Éditions Prunelle ont grandi et cherchent à inspirer la jeunesse. Les livres abordent la question de l’huile de palme, des animaux, etc. Blandine m’explique que dans l’un de ses livres, un chien y raconte son adoption et puis son abandon… Une belle manière d’éduquer et d’amener à la connaissance des plus jeunes, les problèmes de notre société actuelle.
Des livres formatés à l’image d’une société
Mon interviewée a grandi dans les livres. Elle passait son temps à la bibliothèque de son quartier, plongée dès 9 ans dans les grands classiques, à l’image de Victor Hugo. L’ envie de transmettre l’amour de la littérature à ses enfants, l’a poussé à entreprendre et à faire bouger les choses.
Elle pense que nos lectures nous formatent, et en ouvrant de nouvelles pages, elle cherchent à ce que les enfants puissent s’épanouir au-delà des histoires, leur offrant l’opportunité de repenser un monde différent. « La lecture permet de sortir de la noirceur de la vie quotidienne », me confie-t-elle et chacun devrait pouvoir donner le sens qu’il souhaite à la sienne.
Et quand je lui demande pourquoi avoir choisi des e-books…
Le livre: un contenu, non un support
Blandine s’est posée la question de la responsabilité des parents face au numérique. Puis elle s’est dit que la technologie était là et qu’elle était faite pour rester. D’après elle, « beaucoup de jeunes ne lisent plus et restent scotchés sur leur écran ». Autant que la technologie grandisse avec les enfants à bon escient.
Les Éditions Prunelle proposent des e-books de qualité afin de rendre la lecture accessible et ludique au plus grand nombre. L’ avantage du numérique, c’est qu’il peut proposer des contenus adaptés à ceux qui ont des problèmes de lecture. Par exemple, un enfant peut utiliser l’audio, tout en déchiffrant et repérant les mots. Un enfant dyslexique pourra retrouver sa lecture facilitée, avec une police adaptée (les éditions étant en partenariat avec une entreprise, qui a développé un logiciel d’intelligence artificielle à ce sujet). Un enfant autiste se dirigera plus vers une tablette qu’un livre papier, me dit-elle.
De Gaillac à l’international
Les Éditions Prunelle comptent aujourd’hui près de 300 livres. Blandine m’explique qu’il y a pour le moment plus de livres en anglais qu’en français, car le marché anglo-saxon est plus mature. Elle est d’ailleurs entrain de s’implanter au Canada et espère promouvoir ses éditions sur le continent Africain. Des versions bilingues anglais/français sont disponibles actuellement et des traductions en espagnol devraient sortir prochainement. Le e-book reste une belle façon d’apprendre une langue: en lisant en français et en écoutant la version audio en anglais, par exemple.
C’est à travers des histoires que j’aime sensibiliser… des histoires de rencontres, de voyage pour espérer éveiller mon lecteur à travers des mots. Pour Blandine, le but est similaire: éveiller, stimuler sur des sujets de société, de cause animale, écologique ou environnementale, pour que nos enfants d’aujourd’hui deviennent des acteurs du changement de demain.
Posted on mars 20, 2021
Poème du soir
Une journée banale ou presque.
J’ai enfin prévu de me lever à 7h du matin.
Pourtant nous sommes samedi, un jour de week-end.
Mais j’ai besoin de partir prendre l’air.
L’ eau m’est monté à la tête.
Ou peut-être la bouteille de vin entamée de la veille.
Oserais-je écrire que j’ai bu un verre toute seule ?
Seule face à une série qui parle d’âme sœur ?
La journée fut douce et ensoleillée.
J’ai repris la randonnée un brin enflammée.
Je m’étais dit que les 15 km et les 600m de dénivelé,
seraient sans doute un bien paitre trophée.
Se surestimer ? Pour gagner en expérience ou en maturité ?
L’ envie seulement de s’aimer pour ce que l’on est.
Jamais se comparer, toujours avancer.
Et pourtant dans le regard de l’autre, on se voit blessé.
Le vin blanc me monte à la tête.
Peut-être que c’est comme ça que vivent les artistes.
Seules dans cette dualité animale,
Celle qui vous donne des ailes et vous les reprennent.
De haut en bas, comme sur les chemins.
Montant et descendant comme les notes de cœur,
qui s’enflamment puis se font une raison.
Le verre est presque vide.
Faudrait-il à nouveau le remplir ?
Ou le laisser au repos en solitaire,
jusqu’au Printemps prochain ?
Faut-il encore que cicatrisent ces états d’âmes incertains ?
Je referme la bouteille et me rêve au printemps 2019.
C’était la fin d’une année tumultueuse.
Mais j’étais vivante et insoumise.
Encore libre de rêver à danser, aimer et chanter.
Aujourd’hui je suis une âme sèche,
qui ne trouve plus la richesse au cœur des montagnes,
qui trouve la solitude fade,
comme cette bouteille qu’elle vient de refermer,
pour de meilleurs lendemains.